|
Les conférences
s'ouvrirent au
château de la
Jaunais, à une lieue
de Nantes, sur la
route de Clisson.
Une première
entrevue eut lieu le
12 février. Les
délégués de la
République :
Ruelle, Lofficial,
Dornier, Chaillou,
Menuau, Morisson,
Delaunay, Jarry,
Bollet et Pomme
arrivèrent avec le
général Canclaux,
son état-major et
une imposante
escorte. Les plus
beaux soldats, sous
les plus beaux
uniformes, saluent
les guerriers en
sabots, les fusils
rouillés et les
cocardes en papier
blanc.
Charette, avec
Fleuriot, de
Couëtus, Lespinay,
Sapinaud, de Bruc,
de Bejarry,
et 200 à 300 hommes
de cavalerie,
rejoint les
représentants et les
généraux sous la
tente commune. Il
porte fièrement son
panache et son
écharpe blanche.
Au nom de son armée
et de celle du
centre, il remet une
longue série de
propositions qu'il
est impossible
d'admettre sans
abandonner le
territoire à la
discrétion des
chefs, qui
prétendent se rendre
indépendants. On
convient que l'on se
réunirait de nouveau
avant l'expiration
de la trêve fixée au
18. Les 13, 14 et 16
février eurent lieu
de nouvelles
conférences entre
les représentants du
peuple, les
officiers de l'armée
de Charette et les
soi-disant fondés de
pouvoirs des
chouans, Cormartin
et Solilhac.

Canclaux
Le 17 fut le jour
fixé pour la
dernière réunion.
Une tente avait été
préparée dans la
plaine, vis-à-vis du
château de la
Jaunais, où se
tenaient les chefs
vendéens. Les
représentants se
rendirent à cette
tente ; le général
Canclaux, qui les
accompagnait, resta
sur la route avec
quelques officiers
de son état-major et
quelques chasseurs
d'ordonnance.
Les chefs royalistes
insistèrent beaucoup
sur le rappel des
émigrés sans pouvoir
rien obtenir. Les
représentants
n'exigèrent
des chefs vendéens
qu'une déclaration
de soumission à la
République, après
avoir réglé leurs
droits et leurs
prétentions dans
cinq arrêtés qui
portaient, entre
autres conditions,
que les enfants des
rebelles morts ou
suppliciés
rentreraient dans
leurs biens ; que
les
réquisitionnaires
des départements qui
avaient été le
théâtre de la guerre
ne seraient point
appelés ; qu'on
accorderait des
secours et
indemnités aux
habitants de la
Vendée pour les
aider à exister et
relever leurs
chaumières et
maisons ; qu'on
retirerait les
troupes de la
République de
l'intérieur de la
Vendée ; enfin que
l'exercice du culte
serait libre, et que
tous les bons signés
par les chefs dans
les armées du Centre
et de la BasseVendée
seraient remboursés
jusqu'à concurrence
de deux millions
(1).
Charette promit à
son tour de faire
déposer les armes
aux Vendéens, de
former de tous les
déserteurs et gens
sans aveu une garde
territoriale dont il
serait le chef, de
maintenir la
tranquillité
publique dans
l'intérieur de son
département, avec,
cette garde dont il
se réservait
l'organisation,
d'établir les
nouvelles autorités
et de surveiller
l'exécution des
lois.
(1) Beaucoup de bons
historiens
prétendent que le
rétablissement de la
monarchie était
stipulé dans les
clauses secrètes.
Qu'on voie là-dedans
un chef-d'œuvre de
rouerie
républicaine, ou un
modèle de crédulité
royaliste, comme
Napoléon, il n'est
pas téméraire de
croire que cette
promesse secrète,
plus ou moins
dissimulée sous des
artifices de
langage, explique la
presque unanimité
avec laquelle les
chefs vendéens et
chouans, Sapinaud,
Couétus, Cormatin,
les deux Guérin,
Solilhac, de Bruc,
Sauvaget, etc.,
adhérèrent tout à
coup au traité de la
Jaunais, et jurérent
fidélité aux lois de
la République.
FUREUR DES
DISSIDENTS. - REFUS
DE STOFFLET
Mais moins nombreux
furent les
dissidents de la
Jaunais, plus ils
furent violents dans
les deux partis
extrêmes : les purs
républicains
crièrent à la
trahison, et les
purs royalistes à la
lâcheté. Delaunay,
Le Moëlle et Savin
appelèrent les
soldats de Charette
à la révolte, mais
celui-ci les retint
par sa seule
présence.
Le 26
du même mois, les
officiers de la
Vendée faisant
partie de l'armée de
Stofflet signèrent
la déclaration de
Charette dans
l'ordre suivant :
Trotouin, de la
ville de Baugé,
Renou, Martin aîné,
Martin jeune,
Tristan Martin et
Gibert.
Stofflet, entraîné,
par ses amis et
touché par une
lettre que le major
Trotouin lui avait
écrite le 18
février, avait
d'abord pris le
chemin de la
Jaunais, mais il
arriva trop tard (20
février). La
discussion au sein
du Conseil fut des
plus vives. Bernier
persuada à Stofflet
qu'on se moquait de
lui. Il remonte
aussitôt à cheval,
et, agitant son
chapeau devant ses
dragons, il repart
au galop en
s'écriant: « Vive le
Roi ! Au diable la
République et
Charette. » Furieux
des défections qui
se produisent et
l'affaiblissent à
chaque pas, il
arrête Bernard et
Rostaing, poursuit
Sapinaud, pille son
quartier général à
Beaurepaire et
retourne à
Maulévrier, où de
Chantreau et de
Bois-Hardy le
rejoignent et le
sermonnent en vain.
Il prend le titre de
général. en chef de
l'armée catholique
et royale, et le 2
mars déclare
traîtres à Dieu et
au Roi tous les
adhérents à la
pacification.
C'était peut-être
montrer une bonne
foi brutale et une
valeur
chevaleresque, mais
c'était bien peu
connaître les
circonstances, le
pays et les hommes.
L'intelligence de
cet état de choses
faisait le plus
grand honneur au
génie de Charette et
de ses adhérents, et
on ne peut que louer
le dévouement
personnel chez ceux
qui ne le comprirent
pas comme lui.
ENTRÉE TRIOMPHALE DE
CHARETTE DANS LA
VILLE
DE NANTES (26
Février 1795)
Charette, voulant
jouer son rôle
jusqu'au bout, avait
promis de se rendre
à Nantes. Il y entra
par le pont de
Pirmil, le 26
février, comme un
triomphateur, au
bruit du canon,
monté sur son cheval
de bataille,
richement
caparaçonné. Il
portait un de ces
costumes luxueux qui
lui plaisaient tant
: l'habit bleu de
roi, l'écharpe
blanche aux franges
et aux fleurs de lis
d'or, le large
chapeau surmonté
d'un panache blanc.
A sa droite et à sa
gauche, en grand
uniforme, marchaient
le général Beaupuy
et le général
Canclaux. Celui-ci
lui faisait les
honneurs de la
journée avec la
politesse gracieuse
d'un ex-marquis.
Derrière eux
s'avançait Sapinaud,
accompagné de quatre
officiers
républicains et de
quatre officiers
royalistes, suivis
des états-majors des
deux camps mêlés et
confondus : tout ce
cortège était à
cheval.
Entre deux haies de
gardes nationaux,
marchaient les
guides de Charette
ombragés du drapeau
blanc. Des cavaliers
nantais escortaient
les représentants
pacificateurs,
montés dans deux
voitures de gala
ornées du bonnet de
la Liberté ; puis
venait enfin la
cavalerie
républicaine. Toute
la garnison était
sous les armes et
formait la haie pour
contenir la foule,
qui était immense.
Au premier abord
cette multitude
parut étonnée, puis
elle se mit à battre
des mains et à crier
: « Vive Charette
! » Il y eut
même quelques cris
de : « Vive le
Roi ! » qui
allaient trouver
d'imprudents échos,
lorsque les
conventionnels
firent crier « Vive
la paix ! » en
agitant sur leur
passage des drapeaux
tricolores.
Après avoir traversé
les ponts, le
cortège se déploie
dans les rues de
Nantes et fait
lentement le tour
des places
publiques. Tous les
regards sont fixés
sur le grand
capitaine qui, si
longtemps, épouvanta
la République.
L'impénétrable
figure de Charette
s'ouvrait pour
sourire et pour
remercier. Tout à
coup son mâle visage
s'assombrit; il
fronce les sourcils.
On passait devant la
place du Bouffay,
naguère rougie de
tant de sang !
Charette salue avec
respect les ombres
des victimes.
Canclaux et Beaupuy
l'imitent, et les
deux états-majors,
pour s'associer à la
pensée de leurs
chefs, se découvrent
dans un mouvement de
respect unanime.
Ainsi la Terreur
n'était plus que de
l'histoire ancienne
! Charente descendit
et dîna chez les
représentants, et
ses compagnons
furent reçus en
frères égarés, par
les familles
notables de Nantes.
La joie des uns et
des autres tenait du
délire. « Tous sans
doute étaient de
bonne foi ce
jour-là, dit
Crétineau-Jolly; un
enthousiasme pareil
ne saurait être
commandé ! »
Cependant derrière
les amis de la paix
on entendait
murmurer les
derniers
montagnards.
Charette lui-même
les reconnaissait à
leurs yeux sombres ;
et le soir, à la
Société populaire,
où il monta à la
tribune pour
protester de la
sincérité de ses
engagements, il lui
fallut déposer les
insignes vendéens.
Il fut dédommagé au
théâtre par des
acclamations
flatteuses, mais
rien ne put rappeler
le sourire sur ses
lèvres, ni le calme
dans son esprit. Un
doigt fatal comme
celui de Daniel lui
montrait le terme
prochain de ces
expansions, et pour
lui la Roche
tarpéienne était
près du Capitole. On
fit de vains efforts
pour le retenir à
Nantes. Le lendemain
il regagna son camp
au galop.
SINGULIER CONTRASTE
CANCLAUX MARCHE
CONTRE STOFFLET
Tous les royalistes
qui restèrent à
Nantes n'imitèrent
pas la réserve de
leurs chefs, et
pendant que
quelques-uns
insultaient le
drapeau républicain,
les familles
notables ouvraient
leurs maisons aux
proscrits. Ruelle
leur donna
publiquement
l'exemple, et
l'ancien prisonnier
de St-Florent,
Haudaudine,
s'acquitta alors
envers Madame de
Bonchamps. Sa
bourse, sa maison,
son crédit furent
noblement ouverts à
l'illustre veuve et
à tous ses amis.
Pendant ce temps les
chefs vendéens se
calomniaient, et le
2 mars, ainsi que
nous l'avons déjà
dit, un conseil de
guerre présidé à la
Jallais par
Stofflet, déclara
traîtres les
pacificateurs de la
Jaunais et appela
tous les Vendéens à
détruire «cette
œuvre de lâcheté. »
Désespérant de
traiter avec
Stofflet, Canclaux
marche contre lui
(1), et le 18 mars
inflige à Chalonnes
une défaite à ses
lieutenants Chalon
et Poirier de
Beauvais. Le 22
mars, l'ancien
garde-chasse, qui a
pris le titre de
général en chef de
l'armée catholique
et qui, malgré ses
menaces de livrer
aux flammes les
habitations des
métayers qui ne
veulent pas marcher,
n'a pu rassembler
que 7 à 8.000
hommes, dont 6.000
armés, mais presque
sans munitions, se
précipite contre
St-Florent avec la
moitié de cette
levée « à jeun et
tombant de besoin »
dit Lofficial.
Repoussé par les
soldats de Beaupuy,
de Caffin et de
Bonnaire, il perd la
seule pièce de canon
en bronze qui lui
restait sur environ
400 prises à
l'ennemi.
Le 25 mars, Canclaux
part de Nantes (2).
Il fait fouiller la
forêt de Vezins en
tout sens, puis
dirige trois
colonnes sur Cholet,
Chemillé et
Maulévrier, pendant
que Royrand jeune et
Fleuriot,
abandonnant
Beaurepaire,
rejoignent Charette
à Belleville (31
mars). Il est maître
de Cerizais,
Bressuire,
Chatillon,
Maulévrier, Cholet.
(1) D'une lettre
de Charette écrite
de Chauché i1 la
date du 7 mars 1795,
il résulte que ce
général devait
lui-même marcher sur
Stofflet.
(Lofficial, journal
d'un conventionnel,
page 10.)
(2) Le même jour le
représentant Gaudin
protestait.
HÉROISME DES PAYSANS
DE CHAMEAUX TRAITÉS
DE SAINT-FLORENT OU
DE VARADES (2 Mai)
ET DE LA MABILAIS
(20 Avril 1795)
Malgré ces échecs
répétés, les paysans
de Chanzeaux,
retranchés dans le
clocher de leur
église, transformé
en Thermopyles,
renouvellent (9
avril) les prodiges
de la Grande Armée
et se font tuer sur
place : mais ces
dévouements sont
inutiles.
Le 24 avril, pendant
que Canclaux envoie
trois mille hommes
pour couvrir Angers,
des détachements de
Stofflet se glissent
dans l'intervalle
des colonnes
qu'elles harcèlent,
et poussent des
avant-postes jusqu'à
Parthenay. Le 26
avril,
l'adjudant-général
Mathelon découvre
dans la forêt de
Vezins « le dernier
arsenal de l'armée
angevine. » Bernier,
renonçant à
l'impossible, décide
enfin Stofflet à
signer à la
Baronnière, près
Saint-Florent (1),
le traité de la
Jaunais, sauf les
clauses secrètes (2
mai 1795) (2)
Douze jours
auparavant, le 20
avril, les chefs de
la Bretagne avaient
traité à la
Mabilais, de sorte
que toutes les
provinces de l'Ouest
se trouvèrent
pacifiées, du moins
en apparence.
En effet, d'après
les ordres
successifs du Comité
de Salut public,
Canclaux envoie dix
mille hommes à
l'armée des côtes de
Brest et dégarnit le
pays de Charette.
Toute la côte reste
au pouvoir des
royalistes, depuis
Bouin jusqu'à
Saint-Gilles, et les
assassinats des
républicains,
auxquels préside
quelquefois La
Roberie lui-même
continuent. En vain
adressent-ils des
plaintes à Charette
; il avoue à ses
soldats cantonnés à
Belleville qu'il est
toujonrs dans les
mêmes sentiments,
que la disette seule
des grains l'empêche
de rassembler ses
forces, et les
exhorte à prendre
patience.
De son côté Stofflet
revient à Maulévrier
pour désarmer les
paysans, et sous ce
vain prétexte, il a
pour sa garde un
bataillon de
chasseurs francs,
braves, mais
indisciplinés,
toujours prêts à
piller, à tuer : les
mêmes qui avaient
fusillé Marigny et
fait trembler les
habitants des
campagnes.
{1) Après la
signature de la
paix, les chefs
royalistes Stofflet,
de Beauvais,
Cesbron, Delaunay,
etc., dinèrent à
Varades, en face
Saint-Florent avec
les représentants
Ruelle, Chaillou,
Bollet, Jarry et
Dernier.
(2) Le général
vendéen fit
noblement les
choses. Il stipula
le retour en France
de son ancien
maître, le comte de
Colbert, et sa
réintégration dans
tous ses biens.
IMPOSSIBILITÉ
D'EXÉCUTER LES
TRAITÉS DE LA
JAUNAIS ET DE LA
MABILAIS
Ni les Vendéens, ni
les Bretons, ni les
Conventionnels ne se
faisaient d'illusion
sur l'impossibilité
d'exécuter, les
traités de La
Jaunais et de La
Mabilais. De son
côté l'agence
royaliste de Paris,
les marchands
contre-révolutionnaires,
les commis-voyageurs
de Gand, de Vérone,
de Coblentz
poussaient les
Vendéens vers une
alliance honteuse
avec l'Angleterre -
« acceptée » - à
regret par Charette,
il faut savoir le
dire, mais enfin
acceptée ; l'ennemi
le plus dangereux de
la pacification
était toujours le
ministère
britannique, présidé
par Pitt.
Le 20 mai 1795,
Charette s'était, à
Beaurepaire,
quartier général de
Sapinaud, réconcilié
avec Stofflet (1) et
l'expédition de
Quiberon se
préparait
ouvertement. Les
agents de Puysais
allaient et venaient
d'Angleterre en
Vendée. Stofflet et
Charette, en dehors
de ces intrigues que
l'on ne saurait trop
flétrir, car aux
bataillons de
géants ont
succédé les clubs
des pygmées
et des exploiteurs
du sang et de la
gloire des héros.

De Sapinaud
Stofflet et
Charette,
disons-nous,
exécutaient
personnellement les
traités, mais ne
pouvaient empêcher
les conflits de se
multiplier de jour
en jour (2). La
nouvelle Conférence
tenue à La Jaunais
le 8 juin 1795 (le
jour même où Louis
XVII mourait au
Temple), entre le
pacificateur Ruelle,
Charette, Stofflet,
Sapinaud, Fleuriot,
deBruc, Couétus et
l'abbé Bernier,
avait plutôt aigri
les esprits. Les
assassinats
continuèrent sur
différents points et
terrorisèrent les
populations. Le
Comité. de Salut
public perdit
patience et viola
enfin ses serments,
- d'abord en
établissant un poste
à La Mothe-Achard,
puis en ordonnant
l'arrestation de
Charette, à
laquelle Canclaux se
refusa noblement,
et enfin en traitant
de rebelles les
paysans qui se
défendaient contre
les exactions.
Désirant se rendre
compte en tous cas
des forces dont il
pourrait disposer,
Charette avait, le
17 juin 4795, lancé
sur le territoire
des armées du
Bas-Poitou et du
Centre un ordre de
rassemblement.. Afin
que cet appel ne put
être entravé comme
un acte d'hostilité,
il en avertit les
représentants du
peuple, le déclarant
« partiel » en vue
de « répondre aux
plaintes sur
l'inconduite de ses
gens, et aux
soupçons répandus
contre lui-même,
ainsi que d'opérer
le recrutement de la
garde territoriale.
»
(1) Les deux ennemis
s'embrassèrent au
cri de « Vive le Roi
! » Chapelle, dit le
Bouvier-Desmoutiers,
« oublia tout et se
mit en devoir
d'agir. Stofflet
promit tout, garda
son fiel et ne fit
rien ».
(2) A ce moment les
deux armées des
côtes de Brest et de
Cherbourg,
commandées la
première par Hoche,
la seconde par
Hubert-Dubayet,
comprenaient un
effectif de 68.691
hommes de troupe,
distribué en une
infinité de
fractions sur un
immense territoire
composé de treize
départements, savoir
: Ille-et-Vilaine,
Côtes-du-Nord,
Finistère, Morbihan,
Loire-Inférieure,
Maine et-Loire,
Sarthe, Mayenne,
Orne, Manche,
Calvados, Eure et
Seine-Inférieure,
départements qui
présentaient une
surface de quatre
mille lieues carrées
sur un développement
de côtes de prés des
trois cent-cinquante
lieues. Excepté la
Seine-Inférieure,
l'Eure, le Calvados,
la Manche et le
Finistère, tout le
pays était peuplé de
Chouans, sorte de
contrebandiers
organisés par les
quatre frères
Cottereau, des
environs de Laval,
qui, ne marchant que
la nuit pour tromper
plus facilement les
employés de la
gabelle,
contrefaisaient le
cri du chat-huant,
pour éviter toute
surprise et se
reconnaître dans les
bois. De là le nom
de chouan,
corruption du mot
chat-huant. - Sur
les 8.691 manquant
de tout, 12.000
étaient dans les
hôpitaux. C'était a
ce moment quela
Vendée allait encore
se soulever,
envoyant à. Paris,
Amédée de Béjarry et
Scépeaux avec la
mission apparente de
veiller à
l'exécution du
traité, mais avec le
but plus ou moins
déguisé de préparer
les événements du 13
vendémiaire et le
retour des Bourbons.
ARRESTATION
ARBITRAIRE DU
GÉNÉRAL ALLARD

Château de la
Bijoire
De part et d'autre
on s'observait, et
la moindre étincelle
devait mettre le feu
aux poudres. La
réception, plus que
cordiale, faite à un
capitaine déserteur
du 110e régiment,
par le commandant
royaliste Maubée,
campée près la
Bijoire de
Saint-Vincent-sur-Graon,
l'attitude dans
cette affaire de
Charette et du
représentant Gaudin,
avaient tendu à
l'extrême la
situation. Bref, le
20 juin 1795,
l'adjudant général
Cortez (1),
accompagné d'un
bataillon de
chasseurs de Cassel,
vient demander à
dîner au quartier
d'Allard, ancien
aide-de-camp de La
Rochejaquelein, à
qui Charette avait
confié la division
de Joly (2). Après
un repas joyeux, les
Bleus proposèrent au
chef vendéen de le
reconduire,
l'emmenèrent aux
Sables, chez le
représentant Gaudin,
où désarmé, il
n'échappe que par
mirâcle à la,
vengeance d'une
multitude irritée
qui voulait le
mettre en pièces. On
l'incarcère avec
Guerry du Cloudy,
arrêté, déguisé en
tondeur de bœufs, et
deux jours après, il
est embarqué pour La
Rochelle, puis
dirigé sur Fontenay,
où il devait être
jugé par le tribunal
criminel de la
Vendée (3). Charette
proteste, Canclaux a
les bras liés... La
guerre recommence à
la suite d'une
déclaration
solennelle de tous
les cpefs royalistes
(22 juin),
protestant surtout
contre la mort de
l'infortuné Louis
XVII, que la
Convention avait
promis de remettre
aux Vendéens.
(1) Cortez, né en
1761, à Bessay, où
il mourut en 1803,
après avoir combattu
les projets
incendiaires de
Huché, à Luçon.
(2) Le camp du
général Allard était
situé sur une
hauteur entre
Aizenay et Palluau,
et commandait la
route de la
Mothe-Achard.
(3) Allard resta
jusqu'en 1800
prisonnier au
château de Saumur,
prit part aux
soulèvements de 1814
et de 1815 et mourut
entreposeur de
tabacs à Bressuire
en 1846.
REPRISE DES
HOSTILITÉS (26 Juin
1795)
Charette reprend les
armes le 26 juin au
cri de « Vive
Louis XVIII ! »
Un bataillon
républicain qui
venait l'arrêter
passe en masse sous
ses drapeaux, et si
la Vendée n'offre
plus l'ensemble de
l'élan de 1793, elle
tiendra encore la
Convention en échec
jusqu'au jour qui la
verra tomber. A
l'appel de Charette,
ses lieutenants, à
qui il annonce
l'arrivée prochaine
des émigrés à
Quiberon (1) se
lèvent comme un seul
homme. Les convois
de vivres et de
farines, destinées à
la division des
Sables sont
interceptés ; 13
voitures de blé sont
enlevées entre Luçon
et le Givre et
l'escorte massacrée.
Le 28 juin, le camp
des Essarts (2) est
forcé par 1.800
royalistes commandés
par Charette qui, en
rentrant à
Belleville, trouve
son frère de retour
de l'émigration. Les
29 et 30, les deux
Guérin et Sapinaud
battent les Bleus à
Mareuil (3), à
Beaulieu, à Montaigu
et à Aigrefeuille et
leur enlèvent dix
mille rations de
pain et
d'eau-de-vie. Des
officiers et des
soldats bleus,
entassés dans des
maisons vides sont
livrés aux flammes :
la guerre était
changée en
boucherie. A cette
nouvelle le
bataillon des
chasseurs de Cassel
sort du camp de
Pierre-Levée, se
répand dans les
campagnes voisines,
pille, égorge,
incendie et ne
rentre qu'après
avoir tout détruit
le pays environnant.
(1) Le débarquement
eut lieu le 27 juin
1795 sur la plage de
Carnac. La bataille
définitive où Hoche
se couvrit de gloire
eut lieu le 20
juillet. Les pertes
des émigrés et des
chouans furent
considérables. Nous
regrettons que le
cadre que nous nous
sommes tracé ne nous
permette pas de
raconter les
péripéties, de cette
expédition fameuse,
où républicains et
royalistes furent
admirables de
courage et
d'héroïsme.
(2) De Béjarry et
de Scépeaux à Paris.
- Au moment même de
la surprise du poste
des Essarts qui
avait étonné
Sapinaud et
Stofflet, Amédée de
Béjarry avait pu se
faire recevoir en
pacificateur et
traiter en ami par
le général Legros,
au camp de l'Oie. De
là il s'était rendu
auprès de Bernier et
de Stofflet, puis
sur la rive droite
de la Loire, au
quartier général des
Chouans à Pontrou,
où il avait rejoint
son compagnon de
députation, le
vicomte de Scépeaux.
Ensemble, ils se
trouvaient le 6
juillet à Angers.
Ils arrivèrent dans
la capitale « en
costume vendéen,
veste ronde de drap
de gris de fer ou
bleu meunier, avec
revers et parements
noirs, ceinture à
carreaux rouges et
chapeau rond pour
recevoir la cocarde
». Ils furent un
moment les lions de
la capitale,
gratifiés d'une
tribune à la
Convention, , d'une
loge à l'Opéra. Ils
refusèrent d'aller à
la barre de
l'Assemblée
nationale « faire
amende honorable »
et déclarèrent «
qu'ils étaient venus
ici pour défendre la
Vendée, mais non
pour l'humilier ».
-Chassin, La
Pacification de
l'Ouest, tome I,
page 431 et 432. Le
14 août, pendant que
Charette luttait
contre la
République, les
arrêtés de La
Jaunais, de La
Mabilais et de
Saint-Florent
étaient maintenus :
ce qui n'allait pas
empêcher la guerre
de gagner l'Anjou,
ainsi que nous le
verrons plus loin. -
Chassin, tome II,
page 22.
(3) Le jour de la
reprise de Mareuil
(8 juillet), 200
hommes du 110°
passèrent à l'ennemi
avec le capitaine
Loulon.
FORMATION DES CAMPS
DE PALLUAU ET DES
QUATRE-CHEMINS
DÉBARQUEMENT DE
MUNITIONS ANGLAISES
(10 Août 1795)
Canclaux, de son
côté, forme deux
camps, l'un à
Palluau, l'autre aux
Quatre-Chemins de
l'Oie, et fortifie
le poste de La
Mothe-Achard, à
quelques lieues de
Belleville, où
Charette vient de
recevoir de Louis
XVIII le brevet de
lieutenant-général :
ce qui ranime la
rivalité de
Stofflet, en
attendant qu'il soit
fait
maréchal-de-camp et
chevalier de saint
Louis (1).
Au même moment (10
août), l'Angleterre,
dont l'escadre
croisait depuis
plusieurs jours sur
les côtes de
Saint-Jean-de-Monts,
débarque 75
charretées d'armes
et de munitions (2),
que Charette échange
fièrement près de
Saint-Gilles, et
sous le feu des
républicains contre
le blé de ses
paysans... C'était
la première et la
dernière fois que
l'Angleterre tenait
sa promesse.
L'expédition de
l'île d'Yeu allait
compléter la
mystification de
Granville et de
Quiberon (3).
(1) Sur ces
entrefaites (4 août)
se tenait au
Poiré-sur-Vie, sous
la présidence de
l'abbé Brumauld de
Beauregard, un
synode auquel
assistèrent 57
prêtres. Il était
arrivé de Londres le
11 juillet avec
Kersabiec, l'abbé de
Gruchy, Bascber et
Prudent de la
Bassetière,
confirmer
l'espérance de
l'arrivée du comte
d'Artois.
(2) L'envoi, d'après
Charette, comprenait
40 milliers de
poudre, 1.200
fusils, 300 sabres,
1.500 habits
complets, 2 pièces
de campagne et
quelques autres
engins de guerre. En
ce moment, tout
faisait craindre
pour Les Sables un
bombardement des
vaisseaux anglais,
et du côté de la
terre un assaut de
Charette ravitaillé.
(3) L'expédition
de Quiberon coûta 28
millions à
l'Angleterre et
celle de l'île Yeu
18 millions. -
Chassin, T. II, page
72.
DÉPART DU COMTE
D'ARTOIS
Toute l'Europe avait
les yeux sur la
flotte anglaise, qui
amenait le comte
d'Artois aux
Vendéens ! « Les
rois vaincus avaient
partout cédé le
terrain à la
République. La
monarchie n'avait
plus d'autre
palladium que la
bannière vendéenne.
» - « Et cependant
la République était
ensevelie dans son
triomphe ! s'écrie
Napoléon, si le
comte d'Artois eut
touché le sol de la
patrie ! » Mais il
en était séparé par
un double abîme : la
duplicité
britannique et sa
propre
pusillanimité, qui
lui faisait oublier
qu'il y a des heures
où les princes
doivent jouer leur
vie avec plus de
témérité que le
reste des hommes.
Les géants vendéens
n'étaient appelés
que pour mourir
comme les
gladiateurs de Rome,
devant ce César
Pygmée, incapable de
se mettre à leur
tête (1). Et
pourtant les
Vendéens furent
grands, furent
héroïques, par les
Bourbons et malgré
les Bourbons.
Le 25 août (2) le
comte d'Artois se
décide pourtant à
s'embarquer à
Porsmouth, sur la
frégate « le Jason.
» Lord Moira dirige
l'escadre,
qu'accompagnent une
soixantaine de
bâtiments de
transport, portant
les armes, les
munitions et les
secours de toute
nature mis à la
disposition du
prince, escorté par
plus de 150
gentilshommes des
premières maisons de
France,
principalement de la
Bretagne, de l'Anjou
et du Poitou.
Le 12 septembre le
convoi arrive à
l'île d'Houat, où
l'évêque de Nantes,
Mgr de la Laurencie,
célèbre un service
en l'honneur
de Sombreuil et des
autres victimes de
Quiberon. A cette
nouvelle, toutes les
divisions
s'assemblent au cri
de «Vive le Roi !
»
Douze jours se
perdent en
délibérations et en
correspondances pour
savoir si on
attaquera
Noirmoutier ou l'île
d'Yeu ; au lieu de
se jeter sur la
côte, seul avec son
épée, comme Rivière
et quelques
gentilshommes, le
comte d'Artois reste
à la merci du
commodore Waren. «
Il faut s'en
rapporter aux
Anglais »
répétait-il
patiemment, pendant
que Charette, en
essayant de gagner
la côte, pour aller
à sa rencontre, se
faisait battre à
Saint-Cyr-en-Talmondais.
(1) Pitre-Chevalier,
page 550. -
Crétineau-Jolly,
page 377.
(2) Cinq jours
auparavant, la
Convention avait
achevé la seconde
Constitution du 5
fructidor, an III
(22 août, 1795).
Comme celle du 24
juin 1793, elle fut
soumise à la
ratification des
assemblées
primaires. - Elle
fut, le 20
fructidor, an III (4
journée
complémentaire, 20
septembre) acceptée
presque à
l'unanimité par les
assemblées primaires
de la Vendée qui
purent se réunir.
COMBAT DE
SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS
(24 Septembre 1795)
En prévision du
débarquement du
prince français soit
à la Tranche, soit à
l'Aiguillon-sur-Mer,
Charette avait tenu,
le 23 septembre
1795, un Conseil de
guerre à Nesmy. La
Moëlle, nommé depuis
peu au commandement
de la division de
Saint-Vincent-sur-Graon,
insista fortement
pour que l'on
attaquât
Saint-Cyr-en-Talmnondais,
situé dans son
voisinage, sur la
route des Sables à
Luçon, et Guérin
l'avant appuyé,
Charette, renforcé
d'une division du
Centre sous Amédée
de Béjarry, s'y
décida quoique avec
peine. Le 24
septembre on vint
passer la nuit dans
les landes de la
Belle-Etoile,
situées à la limite
de la Boissière et
du Champ-Saint-Père.
Malheureusement le
feu du bivouac se
communiqua aux bois
environnants et
décela ainsi la
marche de l'ennemi
que l'on voulait
tenir secrète (1).
Saint-Cyr, situé sur
une hauteur, n'étant
occupé que par
quatre ou cinq cents
grenadiers, les
Vendéens ne jugèrent
pas à propos
d'emmener de
l'artillerie avec
eux. Ce fut une
faute immense les
Bleus, enfermés dans
l'église qu'ils
avaient percée de
meurtrières,
tiraient à coups
sûrs dans les rangs
des Vendéens. Déjà
La Moëlle était
blessé mais les
royalistes ne
reculaient pas, et
Guérin, qui avait eu
deux chevaux tués
sous lui, voulut
tenter un dernier
effort. Armé d'une
hache, il se
précipitait pour
jeter à bas la
grande porte de
l'église, lorsqu'il
fut frappé de deux
balles en pleine
poitrine, par le
caporal Marca, et
tomba mort sur le
champ de bataille.
La perte d'un chef
intrépide et aimé,
dont Charette suivit
le cercueil en
pleurant (2),
l'approche de la
garnison de Luçon
qui attaquait Pajot,
Lecouvreur et
Caillaud placés en
observation au port
de la Claye,
déconcertèrent les
soldats de Charette,
qui fit battre la
retraite et regagna
le Bocage par le
Champ-Saint-Père,
pendant que le comte
d'Artois, après une
tentative
infructueuse à
Noirmoutier se
décidait à débarquer
à l'île d'Yeu.
(1) Un de ces
bois-taillis a
toujours été connu
depuis dans le pays
sous le nom de la
Gite-Brûlée.
(2) Il fut inhumé au
Petit-Bourg-sous-la-Roche.
DÉBARQUEMENT A L'ILE
D'YEU. - PRISE DE
MORTAGNE
PAR DE BÉJARRY ET DE
SAPINAUD (3 Octobre
1795)
Le 30 septembre il
met le pied à terre
et s'installe au
Port-Breton avec
5.000 fantassins,
1.000 cavaliers et
600 émigrés.
Le duc de Bourbon
l'y rejoint avec un
brillant concours de
nobles. Stofflet
lui-même sort de
l'inaction, et deux
officiers déguisés
en matelots viennent
mettre les troupes
angevines aux ordres
de Monsieur, pendant
que le 3 octobre,
8.000 insurgés aux
ordres de Sapinaud
et de Béjarry
enlèvent Mortagne
défendu par Suzan.
Soixante-dix mille
combattants
l'attendent sans
compter la
Chouannerie bretonne
: l'armée de
Charette,
vingt-quatre mille
hommes ; celle de
Stofflet, vingt
mille ; celle de
Sapinaud et de
Fleuriot, quinze
mille ; celle de
Scepeaux, douze
mille. La situation
était d'autant plus
belle alors pour les
Vendéens, que leurs
adversaires étaient
dans le plus grand
dénuement, et que
les chefs mêmes
manquaient des
choses les plus
indispensables.
ARMÉE DE L'OUEST
LIBERTE
N°265 EGALITÉ
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
ETAT-MAJOR
GÉNÉRAL
A Fontenay, le
16 vendémiaire,
l'an 4e de la
République, une
et indivisible
(8 octobre
1795).
Le Général, chef de
l'Etat-Major Général
de l'armée.
Aux citoyens
administrateurs du
district de
Fontenay-le-Peuple.
Les circonstances où
nous nous trouvons,
Citoyens, me
déterminent a vous
prier de vouloir,
bien me faire
fournir sur un
récépissé, deux
douzaines
d'assiettes, six
plats, trois
douzaines de
serviettes, trois
nappes, une douzaine
de couverts. Avec la
meilleure volonté,
je ne puis me
procurer ces objets
qui sont du premier
besoin.
Salut et fraternité.
E. M. GROUCHY.
Vu la présente
lettre
Le Directoire,
considérant qu'il
n'existe dans les
magasins de
l'administration, ni
plats, ni assiettes,
ni couverts, et que
le linge qui y est,
va être incessamment
vendu conformément
aux ordres de la
commission des
revenus nationaux,
transmis par
l'administration du
département au
Directoire.
Le Président Syndic
entendu,
Est d'avis qu'il n'y
a pas lieu à
délibérer.
Fait en directoire
de district à
Fontenay-le-Peuple,
le 16 vendémiaire,
au ï de la
République, une et
indivisible.
MORISSON
C le
18
vendémiaire pour
le président GUÉRIN
Vu la lettre de
l'autre part du
général Grouchy, en
date du 16
vendémiaire courant,
ensemble, l'avis du
district de Fonténay
du même jour.
Le Directoire de
département ouï le
Pr Gal Sindic
entendu,
A confirmé et
confirme l'avis du
district du dit jour
16 vendémiaire, en
conséquence, déclare
qu'il n'y a lieu à
délibérer.
Fait en Directoire
de département de La
Vendée, à
Fontenay-le-Peuple,
le 18 vendémiaire,
an 4e de la
République française
une et indivisible
(1).
VINET
aîné V. P.
LACOME
, pour le secrétaire
général.
(1) Original,
collection Fillon,
communiqué par Mme
Charrier-Fillon.
ARRIVÉE DE CHARETTE
A LA TRANCHE (10
Octobre 1795)
Le 5 octobre 1795
(13 vendémiaire, an
IV), le jour où la
Convention,
remplacée vingt
jours après par le
Directoire, faisait
mitrailler les
citoyens par Barras
et Bonaparte, le
comte d'Artois écrit
pour la troisième
fois à Charette
qu'il va le trouver
sur un point
quelconque du
rivage. Charette
assemble encore
toutes ses divisions
et marche bravement
vers la mer avec
quinze mille hommes.
Il repousse les
Bleus à Nesmy ; le
10 octobre il arrive
à la Tranche. C'est
là que le prince va
venir... Charette
s'élance hors des
rangs ; tous les
chapeaux s'agitent ;
mais au lieu du
prince on voit
arriver son
aide-de-camp, le
comte de Grignon,
qui annonce que le
comte d'Artois ne
débarquera pas ; que
tout est ajourné !
... « Puis il remet
à Charette de la
part du prince un
magnifique sabre
portant cette
inscription : Je
ne cède jamais !
Charette rougit de
honte et frémit de
rage. Il regarde en
silence
l'aide-de-camp, le
sabre et
l'horizon... » «
Monsieur, répond-il
enfin d'une voix
étouffée, votre
maître m'envoie mon
arrêt de mort. Vous
voyez autour de moi
ces quinze mille
hommes ; demain, il
ne m'en restera pas
trois cents ! Dites
à son Altesse Royale
que je n'en
observerai pas moins
la devise qu'elle
m'adresse : Je ne
cèderai jamais. Je
n'ai plus qu'à fuir
ou à mourir en
brave. Je ne fuirai
pas, moi je saurai
mourir ! »
« Et il tourne la
tête et s'éloigne,
ayant déjà la mort
dans l'âme et
déchargeant sa
fureur contre
l'Angleterre et les
Anglais. »
LETTRES ÉNERGIQUES
DE CHARETTE A LOUIS
XVIII ET A DUMOURIEZ
Le lendemain, dit le
comte de Vauban, qui
a eu la lettre sous
les yeux, Charette
écrivait à Louis
XVIII : Sire, la
lâcheté de votre
frère a tout perdu !
(1)
Ainsi la Vendée,
après avoir versé
tout son sang pour
les Bourbons
recevait le coup
mortel de la main
d'un Bourbon qui, le
18 octobre,
conseillé par sa
maîtresse, Mme de
Polastron, quittait
secrètement l'île
d'Yeu.
Alors surgit le
parti intermédiaire
qui rêvait une
monarcpie
constitutionnelle
avec le jeune duc
d'Orléans. Dumouriez
se fit le champion
de ce parti auprès
de Charette, qui, de
Sainte-FIaive-des-Loups,
lui répondit ces
mots pleins de
laconisme et
d'énergie militaire
: « Dites au fils
du citoyen Égalité
qu'il aille se faire
f... ! », puis
il continua ses
opérations
militaires (2).
Ainsi
s'éclaircissaient
rapidement les rangs
royalistes, lorsque
pour achever la
Vendée, le
Directoire envoyait
le général Hoche
remplacer Canclaux,
malade et rappelé.
(1) Pitre
Chevalier, page 553.
- L'impératrice de
Russie Catherine,
qui avait fourni au
comte d'Artois une
si belle épée
portant
l'inscription : «
Donnée pour Dieu et
pour le Roi ! »,
1.400.000 livres et
des vaisseaux pour
le mener combattre
avec les Vendéens,
ne s'expliquait
guère non plus que
Louis XVIII
s'intitulant roi de
France, ne se rendit
pas dans son royaume
« malgré les
autorités constitués
et non constitués »
faisant dire de lui
: « Voilà un drôle
qui ne se mouche pas
du pied ! » - En le
voyant s'éloigner
comme son frère,
elle s'écriait : «
Il paraît que ces
gens-là voudraient
que les alouettes
toutes rôties leur
tombassent dans la
bouche ! » -
(Catherine Il et La
Révolution
Française, par Ch.
de Larrivière,
in-8°. Paris 1895,
pp. 177 et 178. -
Voir aussi pour
quelques
appréciations La
Vendée Historique,
IIe année, pages
541, 542 et 543.)
(2) Sur ces
entrefaites,
l'Assemblée
électorale de la
Vendée siégeant à
Fontenay, du 20 au
29 vendémiaire, an
IV, 12-21 ( octobre
1795), nommait au
Conseil des Anciens
et au Conseil les
Cinq-Cents,
Goupilleau de
Fontenay, Maignen,
Boissy d'Anglas,
Cochon, Lapparent,
Gaudin l'aîné,
Goussot, Chapelain
et Luminais,
(Chassin. - La
Pacification de la
Vendée, tome II,
page 133). - Les
élections
municipales
contestées eurent
lieu quelques jours
après, partout où
elles purent
s'accomplir.
HOCHE EN VENDÉE
« Lazare Hoche était
né le 25 juin 1768
(1), à Montreuil,
près Versailles,
d'un simple
palefrenier des
écuries royales. La
Révolution le trouva
sergent aux gardes
françaises, et
devinant bientôt son
génie, le fit
général en chef à
vingt-cinq ans.

Hoche
Déjà illustre par
son courage, Hoche
mit le comble à sa
gloire par son
habileté. Au premier
aspect du grand
homme, la Vendée
reconnut le digne
rival de ses géants,
le seul capable de
la vaincre et de la
pacifier (2). Ce
n'était plus
l'incapacité
fanfaronne, ni la
cruauté sanglante de
plusieurs généraux
conventionnels :
c'était la probité
irréprochable, la
supériorité modeste,
la bravoure
sérieuse, la fermeté
modérée, la science
infaillible du plus
grand capitaine de
l'époque après
Bonaparte.
Ses premières
proclamations
annoncèrent à la
Vendée comme à la
République que,
devant son glaive de
pacificateur, toute
la guerre allait
changer de face.
Tel était le nouvel
ennemi que Charette,
épuisé, allait
attaquer dans toute
sa force. C'en fut
encore un véritable
combat de géants.
(1) Hoche, mort au
camp de Wetzlas, le
18 novembre 1797,
s'était marié le 21
ventose, an II (11
mars 1794), avec
Adélaïde Deschaux,
âgée de 16 ans,
fille du directeur
des vivres. Inhumée
à Paris, le 13 mai
1859, après un
veuvage de plus de
soixante ans, elle
avait eu une fille
de Hoche. Ce fut la
femme forte qui
n'eut qu'un époux
comme la Romaine.
(2) Voir dans
Chassin, La
Pacification, tome
II, pages 162 et
163, le résumé des
mesures proposées
par Hoche pour
terminer la guerre
de Vendée. (Voir
aussi à propos de
Hoche, quelques
curieuses lignes
ayant trait à
l'amour de Joséphine
pour lui (page 244).
NOUVEAUX EXPLOITS DE
CHARETTE ABANDON DU
CAMP DE BELLEVILLE
(26 Novembre 1795)
Tandis que Hoche
s'avance avec 15.000
hommes pour cerner
le général poitevin
dans son camp de
Belleville, celui-ci
réunit ses divisions
et leur donne le mot
d'ordre. Il veut
renouveler sa grande
campagne de l'hiver
précédent, et par
des harcèlements
quotidiens couper à
propos les colonnes
républicaines. Ses
soldats sont peu
nombreux et la
défection ou le
découragement les
décime d'heure en
heure ; mais il a
encore autour de lui
ses intrépides
divisionnaires : les
deux La Roberie,
Couétus,
Lucas-Championnière,
Caillaud, Guérin
jeune, Savin, Pajot,
Fougaret qui vient,
succéder à Guérin
l'aîné, etc.
Charette abandonne
avec eux son
quartier de
Belleville (26
novembre 1795),
s'ouvre à
Saint-Denis-la-Chevasse
un passage à travers
un corps d'armée et
les égaille en
tirailleurs dans les
bois des Gâts, non
loin de Dompierre.
De là il fait sa
jonction avec le
général Sapinaud
pour marcher sur
Mortagne. Après
avoir battu les
Bleus au village de
la Châtaigneraie,
non loin de la
Gaubretière, il
retourne dans la
forêt de Grala.
Moins heureux que
lui, son lieutenant
Caillaud n'avait pu
arrêter dans les
landes de
Saint-Sulpice-le-Verdon
une colonne
républicaine, allant
de Montaigu sur
Belleville, et le
lendemain même
Chalbos en informait
l'Administration du
district des Sables
par le laconique
billet dont
l'original est entre
nos mains : Citoys,
Les armes de la
République ont
triomphé ; j'en ai
reçu la nouvelle
cette nuit et je me
hâte de vous la
transmettre à votre
lever.
Salut et
fraternité.
CHALBOS.
Pendant ce temps
Hoche poursuit en
administrateur et en
général son
admirable
stratégie...
Impitoyable
justicier des
capitaines, il
reçoit à merci les
soldats qui se
rendent, donne aux
paysans de quoi
rebâtir leurs
chaumières, accorde
aux propriétaires
toutes les
sauvegardes et aux
prêtres toutes les
garanties qu'ils
peuvent désirer,
fait enlever les
bestiaux, les
femmes, les enfants
de ceux qui
résistent, et les
leur restitue, avec
indemnité lorsqu'ils
déposent les armes.
Il agit moins
noblement
quelquefois ; il
paye les délateurs
et les espions,
conformément à la
politique honteuse
du Directoire. Puis
il enserre dans une
ligne de postes
rapprochés Charette,
qui, le jour en
bataille dans les
landes découvertes,
où sa troupe ne peut
être surprise,
s'échappe la nuit à
travers les colonnes
; mais il est de
plus en plus
resserré.
REPRISE DE MORTAGNE
PAR LES VENDÉENS
Au moment d'être
enveloppé, Charette
engage Sapinaud à
reprendre les armes
avec l'insurrection
du Centre.
L'adjudant-général
Boussard, qui
commande à Mortagne,
veut faire une
reconnaissance
générale, et sort de
la place avec la
plus grande partie
de la garnison ; il
ne voit sur sa route
que des hommes
paisibles occupés
aux travaux de
l'agriculture. A
peine a-t-il fait
quelques lieues que
les Vendéens réunis
surprennent la ville
et massacrent le
reste de la
garnison. Boussard
accourt, il reçoit
deux coups de feu et
sa troupe est
taillée en pièces.
Hoche envoie
aussitôt au général
Willot, qui arrive
de l'armée des
Pyrénées-Occidentales,
l'ordre de
rassembler deux
mille hommes, de
parcourir le
territoire de
Sapinaud et de faire
placarder l'ordre du
jour suivant dans
tous les villages :
« La République
enlève vos grains et
vos bestiaux pour
vous punir de votre
perfidie dans
l'affaire de
Mortagne, rendez vos
armes et vous aurez
vos bœufs. » .
Hoche, de son
quartier général de
Montaigu (1), traque
de son côté Charette
dans les landes et
les bois de La
Roche-sur-Yon.
Pendant un mois,
celui-ci, enfermé
entre La
Roche-sur-Yon,
Bournezeau et
Saint-Hilaire-le-Vouhis,
lui échappe en le
harcelant,
disparaissant tous
les soirs et
reparaissant tous
les matins, enlevant
les convois à
l'improviste, se
retranchant de
taillis en taillis
et de buisson en
buisson, toujours
insaisissable. Hoche
désespère un moment
de vaincre un pareil
homme Quatre mille
de ses soldats sont
blessés ou
malades... Les
autres sont harassés
ou découragés.
APERÇU DES
RESSOURCES LOCALES
QU'OFFRENT LES
COMMUNES CI-APRÈS :
|
NOMS
DES
COMMUNES
|
ATTELAGES
|
QUANTITÉ
DE
BESTIAUX
EXCEDANT
LES
ATTELAGES
|
|
Voitures
|
Bœufs
|
Jeunes
bœufs
|
Vaches
|
Moutons
|
Chevaux
|
|
Mortmaison
|
30
|
60
|
15
|
50
|
20
|
3
|
|
Bouay
|
80
|
180
|
60
|
150
|
50
|
6
|
|
Saint-Hilaire-du-Bois
|
30
|
60
|
30
|
50
|
-
|
-
|
|
Saint-André-Treize-Voies
|
40
|
90
|
50
|
80
|
30
|
4
|
|
Vieillevigne
|
200
|
500
|
50
|
500
|
80
|
20
|
|
La
Grolle
|
40
|
80
|
15
|
50
|
10
|
3
|
|
Montbert
|
50
|
100
|
50
|
100
|
20
|
4
|
|
La
Boissière
|
40
|
120
|
30
|
100
|
50
|
5
|
|
Saint-Fulgent
|
10
|
20
|
40
|
10
|
25
|
4
|
|
Charognes
|
30
|
60
|
60
|
60
|
30
|
12
|
|
St-André-Goule-d'Oie
|
7
|
14
|
20
|
80
|
20
|
8
|
|
Treize-Septiers
|
20
|
50
|
20
|
40
|
15
|
2
|
|
La
Bruflière
|
50
|
109
|
50
|
150
|
30
|
2
|
|
Saint-Denis-la-Chevasse
|
50
|
100
|
80
|
300
|
10
|
15
|
|
L'Herbergement
|
5
|
20
|
44
|
30
|
20
|
3
|
|
La
Bernardière
|
30
|
60
|
20
|
40
|
30
|
-
|
|
La
Copechagnière
|
10
|
20
|
20
|
30
|
10
|
4
|
|
Totaux
|
722
|
1.684
|
614
|
1.830
|
450
|
95
|
Certifié véritable
d'après la
déclaration des
commissaires des
dites communes.
Montaigu, 7 ventôse,
an IV (26 février
1796)..
Le Commissaire des
guerres, MONGENOT.
Le Général en chef,
HOCHE.
(1)
Nous croyons étre
agréable à, nos
lecteurs en publiant
ci-dessus un tableau
trouvé aux Archives
de Fontenay.
LA TÊTE DE CHARETTE
MISE A PRIX LETTRE
DE SOUVAROW
Hoche fait, alors
une chose indigne de
son caractère : il
met à prix la tête
de Charette. - «
Charette a six mille
louis en or,
écrit-il à Delaage,
promettez-les à
quiconque l'amènera
mort ou vif. »
Honneur à la Vendée
! Elle n'aspirait
qu'à voir finir
cette guerre et elle
n'eut pas un traître
pour vendre son
général !
Cependant Charette
sent que l'heure
fatale approche. Il
assemble ses
derniers braves et
leur dit : « Je vous
rends vos serments,
messieurs, cherchez
à vous sauver, je
l'approuve ; quant à
moi, j'ai juré de
mourir les armes à
la main, je tiendrai
ma parole... »
Une seule voix
répond à ce discours
: « Nous mourrons
tous ensemble ! Au
même instant, un
courrier pénètre
dans la forêt de
Grala, où cette
scène avait lieu, et
remet à Charette une
lettre de Souvarow,
l'illustre général
russe : « Héros de
la Vendée, glorieux
défenseur de la foi
de tes pères et du
trône de tes rois,
salut ! Que le Dieu
des armées veille à
jamais sur toi ! Et
vous, immortels
Vendéens, dignes
compagnons d'un
grand homme, relevez
le temple du
Seigneur.... Brave
Charette, honneur
des chevaliers
français, l'Europe
étonnée te
contemple, et moi je
t'admire et te
félicite... Gloire à
toi !
Ce 1er octobre à
Varsovie.
Signé : Souvarow. »
Cette lettre, venue
d'un pays si
lointain, et
adressée par un des
hommes les plus
compétent sen fait
de bravoure et de
gloire, dut être
sensible à Charette
; mais les derniers
jours du héros
approchaient, et la
modération de Hoche
prenait le dessus.
Il va partout
répétant : «
Respectez le culte
et les prêtres. »
« Allez à la messe,
s'il le faut»,
écrit-il à ses
lieutenants. Il
rallie ainsi un
grand nombre
d'anciens curés qui,
ne voyant plus de
dangers pour la foi
dans la
pacification, s'en
font les
missionnaires au nom
de l'évangile du
pardon... Les
officiers de
Charette, ceux qui
naguère
s'obstinaient encore
à mourir avec lui,
comprenant la
nécessité de faire
la paix, invitent
par un Mémoire (1)
les populations à
déposer les armes.
(1) Rédigé au
château de la
Grange, près de
Rocheservière.
MORT DE LA ROBERIE
ET DE PAJOT
Charette s'indigne
d'un tel revirement
et le reproche aux
signataires, surtout
à Prudent de La
Roberie, qu'il
aimait comme un
fils. Les officiers
se repentent et
battent dès le
lendemain les Bleus
à la Thébaudière, où
Prudent se justifie
par un trépas
héroïque, en se
lançant presque seul
sur le bataillon
ennemi, au passage
de la Boulogne, non
loin de Mormaison.
Le succès de ce
combat ne put
consoler Charette
qui s'écria en le
voyant étendu sous
ses yeux . « Pauvre
Prudent, mort
aujourd'hui comme
nous mourrons
peut-être demain ! »
Le jour même des
funérailles de La
Roberie à Saligny,
les Bleus, revenus à
la Thébaudière,
furent encore battus
par Charette. Le 24
décembre, Lucas
Championnière, l'un
de ses meilleurs
officiers, envoyé
pour intercepter un
convoi près du
chateau de Chatenay,
commune de
Saint-Denis-la-Chevasse,
ne put atteindre que
l'arrière-garde, et
l'armée perdit, dans
une embuscade,
l'intrépide Pajot,
commandant de la
division de Bouin,
un des plus
terribles paysans et
des caractères les
plus originaux du
Bas-Poitou. Au même
moment, Savin et de
Béjarry aîné
faisaient leur
soumission.
ARMÉE DE
L'OUEST 30 B. - F.
84 - N. 1
LIBERTE EGALITE
DIVISION
Au Quartier général
à Fontenay le 8
nivôse, an quatrième
de la République
française une et
indivisible (29
décembre 1795).
Willot, général de
division, commandant
l'armée.
Aux administrateurs
du Département de la
Vendée :
Citoyens
administrateurs, je
vous remercie de
votre attention ;
J'étais instruit de
la soumission de
Savin dont
j'avais reçu une
lettre. J'ai
transmis au
gouvernement les
plaintes
malheureusement trop
fondées de
l'administration
municipale de
Saint-Gilles, j'en
ai envoyé copie au
gouvernement à qui
je ne tairai jamais
la vérité ; j'ai
pris de mon côté
tous les moyens qui
dépendent de moy
pour rappeler les
troupes qui sont
dans ce canton à la
discipline, j'en
fait sortir la 6e ½
Brigade que l'on
m'avait notté pour
s'être mal conduite
; la tettre que.
vous m'avez fait
l'honneur de
m'adresser le 3 ne
m'a été remise
qu'aujourd'huy.
Encore quelques
jours et je ferai
occuper la Cayère.
J'espère que toute
la partie à la
droite de la route
de Nantes sera sous
peu paisible.
Le
citoyen Bejarry
l'aîné
est
venu lui-même à la
tête de différentes
communes, me
remettre ses armes.
Il y a quelques
jours, 25 déserteurs
de nos troupes ont
été pris par le
cantonnement des
Herbiers, ils
nous ont fait
trouver 26 barils de
poudre : parmi eux
sont plusieurs chefs
ci-devant officiers
de nos troupes, je
les fait conduire à
Fontenay (1).
Salut et fraternité.
WILLOT.
(1) Original :
collection Fillon,
communiqué par Mme
Charier-Fillon.
ATTAQUE DU CAMP DES
QUATRE-CHEMINS
(28 Décembre 1795)
Ainsi Charette
voyait tomber autour
de lui tous ses
lieutenants.
Impassible comme la
mort, il continue
d'aller au-devant
d'elle.
Instruit que la
division Caillaud se
trouvait vivement
pressée par l'ennemi
vers les Ceriziers,
dans la forêt de La
Chaize, Charette se
porte de ce côté, et
après l'avoir
ralliée, il court
attaquer le camp des
Quatre-Chemins de
l'Oie. Secondé
énergiquement par
Championnière,
Collin, Beaumelle et
Couétus, il remporte
là sa dernière
victoire malgré une
énergique résistance
des Bleus (28
décembre 1795).
Deux jours après, il
fait célébrer une
messe solennelle à
la Roulière, de la
paroisse du Poiré :
l'abbé Remeau absout
les soldats et bénit
leurs armes. « Et
maintenant, où
allons-nous, demande
Championnière. » -
«Droit aux Bleus »,
répond Charette.
Mais écrasé aux
Trois-Moulins par le
général Travot qui
lui prend son
drapeau et toutes
ses munitions, il
est entraîné dans la
déroute des siens
qui se dispersent de
tous côtés.
COMBAT
D'AIGREFEUILLE, 1-2
JANVIER 1796
RETRAITE SUR LA
BRUFFIÈRE
Poursuivi par trente
mille hommes,
entouré d'une
poignée de soldats,
sans vivres, sans
munitions et blessés
pour la plupart, le
héros du Bas-Poitou
ne cède pas encore à
la fortune, et il
songe à gagner le
pays de Stofflet,
pour engager le
général à lui porter
secours. Dans la
nuit du 1er au 2
janvier 1796, il
attaque et repousse
une colonne ennemie
près d'Aigrefeuille
; mais atteint
bientôt par de
nouveaux renforts,
il se replie sur la
Bruffière, où il
comptait trouver
quelques instants de
repos : pour la
première fois il y
rencontre la
trahison. « Elle
avait revêtu la
forme charmante de
Mademoiselle de
Grégo, fille de la
marquise de ce nom.
Confidente de tous
les chefs
royalistes, cette
dame s'éprend de
Hoche et lui livre
les secrets de ses
ennemis. Des prêtres
et des paysans
l'imitent, séduits
par l'or du
Directoire. » A
peine Charette
était-il installé à
la Bruffière, que
Travot y arrive et
tombe à l'improviste
sur les Vendéens
harassés. C'en était
fait de l'armée, si
Charette, par un
dernier effort, ne
se fut fait jour à
travers les colonnes
de Travot, et n'eut
réussi à gagner les
Landes-Genusson. Là
il rencontre quatre
bataillons qu'il
culbute pour arriver
à Chavagnes, et
ensuite à Belleville
avec les débris de
sa troupe.
Il n'avait plus ni
poudre ni pain, et.
les désertions
éclaircissaient les
rangs de Charette.
Les chasseurs
volontaires bretons
venaient de
l'abandonner, et les
officiers du pays de
Retz qui n'osaient
demander la paix,
licencièrent leurs
troupes à
Saint-Marc-de-Couté.
Pressé par des
forces supérieures,
le chef de la Vendée
envoie le comte de
Suzannet et d'Argens
informer les princes
de sa situation ;
mais déjà de
nouveaux partisans
l'abandonnent.
GUET-APENS CONTRE
COUÉTUS
Le fidèle Couétus
lui-même, ce Lescure
du Bas-Poitou,
obtient un armistice
du général Gratien,
moine et prêtre
apostat, et se
charge d'amener
Charette à la paix.
Charette lui donne
en effet son
assentiment quoique
avec défiance.
Couétus, avec MM.
Thouzeau, Dubois et
Lapierre, se rend au
château de l'Epinay
sur la parole de
Gratien. Des avis
secrets lui
annoncent une
perfidie !... Il
refuse de les croire
et se voit arrêté au
milieu de la nuit,
avec deux de ses
compagnons, jugé par
une Commission
militaire et fusillé
contre toutes les
lois de l'honneur.
On le somme de
racheter sa vie par
un mensonge, en
déclarant qu'il
n'avait pas commandé
l'avant-garde aux
Quatre-Chemins. - «
Le fait est vrai,
répondit-il
noblement, comment
voulez-vous que je
le nie ! »
Et pourtant il faut
savoir le
reconnaître, les
instructions données
par le ministère à
ses représentants et
aux généraux avaient
toutes pour but ; de
maintenir la
discipline,
d'assurer le respect
des propriétés et
des personnes, et
d'arriver ainsi à
une ère
d'apaisement.
Paris, le 27
pluviôse, an IV (16
février 1796) Le
Ministre de
l'Intérieur
Au commissaire du
pouvoir exécutif
près
l'administration
centrale du
Département de La
Vendée,
A
Fontenay-le-Peuple,
Citoyens, j'ai reçu
les différentes
lettres par
lesquelles vous me
peignez les excès
auxquels se livrent
les soldats dans le
département de La
Vendée, les
réquisitions de
grains et de
bestiaux qui s'y
font arbitrairement,
et l'effroi que
cause la mise en
état de siège de la
commune de
Fontenay-le-Peuple.
J'ai écrit au
général Hoche
relativement aux
deux premiers
objets. J'appelle
toute son attention
pour réprimer la
licence du soldat,
empêcher les
réquisitions
arbitraires, et
mettre un frein à la
cupidité des
entrepreneurs de
vivres.
J'écris au ministre
de la guerre pour
m'assurer de la mise
en état de siège de
la commune de
Fontenay-le-Peuple
et des motifs
qu'auraient pu
nécessiter cette
mesure extrême.
J'applaudis au zèle
de l'administration
du département et à
celui qui vous anime
dans l'exercice de
vos fonctions. Je
vous invite, ainsi
que l'administration
àcontinuer de donner
tous vos soins pour
maintenir le respect
dû aux personnes et
aux propriétés, à
rappeler avec
courage le militaire
à son devoir, enfin
à vous concerter
avec les généraux
pour retenir les
troupes dans la
discipline la plus
sévère et les faire
punir toutes les
fois qu'elles s'en
écarteront.
En mettant la
justice et la raison
de votre côté, vous
serez toujours
supérieur aux petits
désagréments que
voudrait vous causer
l'amour-propre de
quelques individus
que vous auriez
heurtés de front.
Vous devez attacher
toute votre gloire à
consolider la
pacification, à
ramener l'ordre et
la paix dans La
Vendée, et avec elle
le bonheur dont les
habitants de ces
contrées sont privés
depuis si longtemps.
J'aime à me
persuader que vous
pouvez par vos soins
assidus, accélérer
la guérison de ce
chancre politique
qui la dévore.
Personne n'éprouvera
plus de satisfaction
que moi, en
applaudissant à vos
heureux travaux.
Salut et fraternité,
Signé: BENEZECH
Le chef de la Ire
Division,
Signé: CHAMPAGNEUX
STOFFLET REPREND LES
ARMES. - SA MORT
(25 Février 1796)
Le lâche assassinat
de Couétus exaspéra
les derniers
survivants de la.
Grand'Guerre, qui se
resserrèrent autour
de Charette avec le
courage du
désespoir.
De son côté,
Stofflet, cédant aux
sollicitations des
agents de Puisaye,
de Scépaux, de
Charette et du comte
d'Artois, profite de
l'occasion pour
s'élancer hors de
ses cantonnements
(1) et en faire
aviser à Edimbourg
le comte d'Artois
par le chevalier de
Colbert de
Maulévrier : « Nous
marchons tous à
l'échafaud, dit-il à
ses officiers, mais
tout le monde pousse
à la guerre,
faisons-là donc
jusqu'à la fin ! »
Il se rue le 20
janvier 1796 sur
Argenton-le-Château
avec trois cents
hommes, en chasse
les républicains et
s'empare de toutes
leurs armes. Ce fut
le dernier exploit
du chef angevin. Le
29 du même mois un
de ses lieutenants,
Vasselot, essayait
d'enlever Fontenay.
Mais Hoche avait
trouvé le mot
d'ordre qui devait,
compléter son
triomphe : - « Mort
aux officiers
vendéens ! Grâce aux
soldats ! ... » Tous
les soldats se
rendirent et, les
officiers restèrent
seuls. Déjà Sapinaud
est paralysé et,
Stofflet va être
pris. Hoche arrive à
Chemillé le 28
janvier 1796 avec
trois régiments. Les
partisans Guichard
et Nicolas, les plus
anciens chefs de
division de l'Anjou,
sont pris les armes
à la main et
fusillés à l'instant
(14 février). - Le
23 février, Bernier
attire de la forêt
de Maulévrier
Stofflet et son
Conseil à la
Saugrenière. Le
garde-chasse y paye
sa dernière dette à
ses maîtres en
nommant le comte
Colbert de
Maulévrier agent
général auprès de
Louis XVIII. Au
milieu de la nuit le
Conseil se sépare.
Bernier disparaît...
« que devint-il et
que fit-il ? dit
Crétineau-Joly.
C'est le secret de
Dieu qui l'a jugé !
» A quatre heures du
matin Stofflet
dormait avec
Lichteningen, son
aide-de-camp,
Coulon, son
secrétaire,
Eroudelles, député
des Chouans, envoyé
par Scépeaux et
trois domestiques,
lorsqu'un
détachement bleu
conduit par Lourtil
(2) cerne la
métairie, force la
porte et assiège le
lit du général. Il
se lève à demi nu,
sans arme, terrasse
trois républicains
et allait peut-être
échapper (3),
lorsque des sahres
et des baïonnettes
lui percent le corps
et les bras, et lui
abattent le front
sur les yeux.
Il chancelle alors,
aveuglé par son
sang, et les Bleus
le garottent en
criait : « Vive la
République ! » (4).

Stofflet
On lui enlève
aussitôt le reste de
ses vêtements
ensanglantés ; on
lui jette sur le dos
une méchante blouse
bleue et on le
traîne pieds nus
jusqu'à Angers, où
il comparaît devant
la Commission
militaire. Là, toute
la fermeté de ce
caractère
indomptable se
résume dans le
silence du mépris.
Il refuse même de
prononcer son nom,
écoute sans
sourciller son arrêt
de mort et marche au
supplice (5) avec
Lichteningen et
Moreau, ses aides de
camp, Joseph
Devarannes et Pierre
Pinot.
Le général Thorigny
veut lui faire
bander les yeux.
- « Arrière ! dit-il
en repoussant
l'exécuteur de sa
main sanglante : les
généraux vendéens
n'ont pas peur des
balles ! »
Il regarde avec
calme charger les
fusils, joint les
mains, lève les yeux
au ciel et expire
sous les balles
républicaines en
criant : « Vive la
Religion ! Vive le
Roi ! »
Ainsi périt à
quarante-trois ans
(25 février 1796), à
neuf heures du
matin, le chef des
royalistes de
l'Anjou. Simple
soldat, il avait
levé le premier, le
10 mars 1793,
l'étendard de
l'insurrection, et
avait eu ensuite
l'honneur de
commander une armée
de soixante mille
hommes (6).
Charette voyait
tomher avec Stofflet
sa dernière
espérance. Le jour
même de sa mort,
Bernier lui donnait
pour successeur
d'Autichamps.
(1) Une entrevue
qu'il avait eue au
May, près Cholet,
avec Hoche, le 12
décembre, n'avait
donné aucun
résultat, grâce aux
intrigues de l'abbé
Bernier.
(2) Edmond
Stofflet. -
(Stofflet et la
Vendée, page 407),
prétend qu'un
Vendéen du nom de
Guichard, s'offrit
pour conduire à la
cachette de son
général, et qu'il
fut fusillé comme
ayant égaré la
troupe répubhcaine.
(3) Il fut
appréhendé par le
grenadier Audious. -
Il fut conduit à
Chemillé et de là
traîné à Angers.
(4) Bretagne et
Vendée. - Darmaing.
{5) Il fut exécuté
au Champ de Mars.
(6) Avant de
recevoir la décharge
mortelle, Stofflet,
reportant alors sa
pensée vers la
Lorraine, berceau de
son enfance, demanda
s'il se trouverait
un Lorrain parmi les
militaires qui
formaient le funèbre
cortége. Un soldat
sortit des rangs et
le général lui fit
cadeau de sa montre,
le seul objet dont
il put disposer.
NOBLE ATTITUDE DE
CHARETTE EN FACE DES
PROPOSITIONS DE
HOCHE
Cependant Hoche,
poursuivant Charette
de gîte en gîte,
achevait de le
mettre au ban des
villageois et du
clergé, et ce fut
par l'abbé Guesdon
(1), curé de la
Rabastelière, qu'il
lui fit proposer au
nom du général
Gratien, de le
laisser sortir de
France avec tous
ceux qui voudraient
l'accompagner; de
lui restituer tous
ses revenus et de
lui faire verser un
million aussitôt son
arrivée en pays
étranger.
« Moi fuir !
répondit Charette ;
abandonner les
braves que je
commande ! Jamais !
Tous les vaisseaux
de votre République
ne suffiraient pas
pour les transporter
en Angleterre, ni
ses armées pour leur
servir d'escorte !
Loin de craindre vos
menaces, j'irai vous
attaquer dans votre
camp!
Cependant, ses
derniers lieutenants
mouraient ou se
rendaient. Amédée de
Béjarry, Ussault et
Pranger étaient
arrêtés et Sapinaud
placé en
surveillance. Le
Moëlle, commandant
la division de
Saint-Vincent-sur-Graon,
s'étant rendu dans
une ferme pour y
faire un
rassemblement, y est
surpris par les
Bleus, et moins
heureux que ses
compagnons,
Caillaud, Beaumel,
Desabbayes et, de La
Voirie, il tombe
percé de quinze
balles... « Moi
seul, disait-il,
comme La Médée
antique, moi seul et
c'est assez ! » Le
20 février 1796, à
la tête de deux
cents cavaliers et
de quatre-vingts
fantassins, il livre
à la colonne Travot,
près de la
Bégaudière de
Saint-Denis-laChevasse
(2), son
cent-septième
combat. Il voit
périr autour de lui
son cousin, Charette
de la Colinière,
Beaumel, presque
tous ses amis. Il
continue de se
battre au milieu de
leurs cadavres, et
va passer la nuit
dans les bois de
Grammont, au milieu
de leurs fantômes.
Le lendemain,
Lecouvreur,
commandant de Légé,
Hyacinthe la Roberie
et Guérin jeune font
leur soumission, et
Charette, malgré sa
proclamation du 21
février, portant
peine de mort contre
ceux qui ne le
suivraient pas,
reste seul avec
trente-deux hommes
déterminés, mais
harassés, épuisés et
mourant de faim
comme lui-même.
Le 4 mars, Travot ne
sait plus ce qu'est
devenu Charette. Le
8, il le retrouve au
château de la
Grossetière,
territoire de
Froidfond, au milieu
de 30 rebelles à
pied.
(1) Quelques jours
après, le curé
Guesdon, soupçonné
de dénonciation, fut
enlevé nuitamment de
son domicile et
fusillé dans une
lande avec ses deux
domestiques. Travot
accuse formellement
Marelle de cette
exécution, mais le
fait n'est rien
moins que prouvé.
Pour l'exécution
de l'abbé Guesdon,
voir la Revue du
Bas-Poitou, 5e
année, pages 332,
333, 334.
(2) Ce fut
notamment ce jour-la
(20 février 1796),
que quelques
officiers
supplièrent Charette
d'accepter les
offres de la
Convention et de
quitter la France.
Revue du Bas-Poitou,
Ve année, page 333.
CHARETTE PRIS A LA
CHABOTERIE (23 Mars
1796)
Travot l'atteint
enfin au village de
la Chauvière, mais
il résiste encore.
Dans ce combat, il
voit tomber près de
lui le chevalierde
la Jaille et le
brave Caillaud. Il
échappe pourtant,
mais il n'a plus
d'asile : une fièvre
ardente le dévore ;
il est pressé par le
besoin et n'ose
réclamer aux fermes
sur sa route ni un
peu de pain ni un
peu de repos. Toutes
les fermes sont
occupées par des
soldats acharnés à
sa poursuite. Le 23
mars, son armée
était réduite à
trente-deux hommes.
Lui-même n'avait
plus de cheval et
courait à pied nuit
et jour, lorsque
quatre colonnes le
cernent à la
Prélinière, dans la
paroisse de
Saint-Sulpice-le-Verdon
(1). - C'est ici,
s'écrie-t-il, qu'il
s'agit de lutter
jusqu'à la mort et
de vendre chèrement
sa vie ! Seul avec
ses trente-deux
compagnons, il
soutient pendant
trois heures la
charge de deux cents
grenadiers et
chasseurs. Douze
cadavres lui servent
de retranchement. -
Il reçoit un coup de
feu à la tête ; un
coup de sabre lui
coupe trois doigts,
mais il résiste
encore... Un
dévouement sublime
prolonge alors ses
jours... Un
déserteur alsacien,
Peffer, qui a pour
lui une espèce de
culte « poussé
jusqu'à la férocité
la plus sanguinaire
envers ses ennemis
», lui donne son
chapeau et prend le
sien où flotte le
panache blanc. « Mon
général,
s'écrie-t-il alors,
sauvez-vous ! A
l'aide de votre
panache je les
attirerai tous sur
moi, et ils me
tueront ». Peffer
avait dit vrai. Cinq
grenadiers de
Valentin le
massacrèrent, tandis
que Charette gagnait
le bois de l'Essart,
près la Chaboterie.
Là, paraît la
colonne Travot. Un
nouveau et suprèrne
combat s'engage.
Haletant, épuisé,
perdant son sang par
trois blessures, le
général chancelle.
Le vendéen Bossard,
domestique de
Charette, le charge
sur ses épaules.
Bossard est frappé à
mort. Le jeune
Laroche-Davo
s'approche pour
saisir ce glorieux
fardeau ; comme
Bossard, il meurt
sous les balles
républicaines. Un
troisième, dont le
nom est
malheureusement
ignoré, se dévoue
encore (2).Charette,
sans connaissance,
est déposé dans un
bois, près de la
Chaboterie. Travot,
cinq minutes après,
y pénètre avec ses
voltigeurs (3). Le
chef royaliste est
fait prisonnier,
mais en rendant son
épée il a retrouvé
son énergie...

Dernier combat de
Charette
Travot et ses
officiers le
traitent avec le
respect que mérite
un héros... On le
conduit de suite au
Pont-de-Vie, commune
du Poiré, à Montaigu
et de là à Angers,
pour le diriger sur
Paris, où la
nouvelle de la prise
de Charette, arrivée
à huit heures du
soir, est accueillie
par des acclamations
enthousiastes.
« Charette est pris
! Charette est pris
! » cette conquête
électrise toute
l'armée républicaine
! et les membres du
Directoire le font
annoncer sur tous
les théâtres, -
comme ils eussent
fait de la prise
d'une capitale et
d'un royaume...
Mais la population,
refusant de croire
une nouvelle si
souvent publiée et
si souvent démentie,
Hoche estime qu'il
doit faire juger
Charette à Nantes,
et que le théâtre de
sa gloire doit être
celui de sa mort.
Traduit devant la
Commission
militaire, il est
condamné à mort, et
après avoir été
promené (chose
épouvantable et
atroce à l'actif de
Dutilh, comme un
trophée vivant à
travers la ville),
Charette écoute son
arrêt de mort avec
un sang-froid
imperturbable. Après
s'être entretenu une
heure avec les
généraux
républicains qu'il
étonne par son
sang-froid, il se
confesse à l'abbé
Guibert, et c'est en
écoutant les
suprêmes
exhortations du
vénerable prêtre
qu'il arrive jusqu'à
la place Viarmes. Il
demande à parler à
Travot. Puis après
une conférence à
voix basse de deux
minutes à peine, il
se rend d'un pas
ferme au milieu de
la place, où sont
rangés cinq mille
hommes. Il jette un
coup d'œil froid sur
le cercueil prêt à
recevoir son
cadavre, repousse
doucement le bandeau
qu'on voulait poser
sur ses yeux, et
présentant sa
poitrine au piquet
chargé de
l'exécution, il
place la main sur
son cœur en disant :
« Frappez-là ! C'est
là qu'on doit
frapper un brave! »
Le signal est
immédiatement donné
par un officier :
Charette incline la
tête, les soldats
tirent et il meurt
en criant : «
Vive le Roi ! »
Telle fut, à l'âge
de trente-trois ans
(29 mars 1796), la
fin de cet homme
extraordinaire, qui
lutta pendant trois
ans contre les
forces de la
République, avec une
multitude sans ordre
et sans discipline
qu'il faisait
trembler. Arrogant
dans la prospérité,
ombrageux et souvent
sanguinaire dans
l'infortune,
toujours plein d'une
insouciance
soldatesque pour les
souffrances des
autres comme pour
les siennes, il ne
sut point profiter
de l'armistice pour
se ménager des
intelligences dans
la Bretagne et la
Normandie, et pour
se faire un grand
parti dans la
capitale, quand la
faiblesse du
gouvernement lui
permettait de tout
oser. Mais il fut
admirable dans ses
revers et surtout
dans ses derniers
jours. On le voyait,
le sourire sur les
lèvres, inspirer sa
patience à ses
soldats, et leur
faire supporter
gaiement les
privations
auxquelles ils
s'était le premier
accoutumé. « Jamais
capitaine, depuis
Mithridate, dit
Chateaubriand,
n'avait montré plus
de ressources et de
génie militaire (4).
»
(1)
D'après le récit du
garçon meunier
Jaunâtre, qui
demeura auprès du
chef vendéen
jusqu'au bout,
Charette s'était, la
veille, dans la
nuit, présenté
mouillé jusqu'aux
os, dans une maison
des Lucs. Il se
sécha auprès du feu
sur un banc de bois
et fit son dernier
repas d'un œuf.
Jaunâtre, un des
rares survivants des
derniers combats de
Charette, se fit
maçon après la paix,
vint s'établir dans
le canton de
Chantonnay, et
travaillait souvent
pour Amédée de
Béjarry ; grand-père
du sénateur actuel.
C'est lui qui fit la
maçonnerie du
bâtiment où était
l'ancienne chapelle
du château de La
Roche-Louherie, dans
la commune de
Saint-Vincent-Puymaufrais.
Il y eut un doigt
écrasé par la chute
d'une pierre.
Jaunâtre contait
volontiers
l'histoire de la
Grand'Guerre et
l'accident de son
doigt ; il doit être
mort en 1847. (De
Béjarry. Souvenirs
vendéens, page 211).
(2) Jaunâtre, garçon
meunier des Lucs,
dont nous avons
parlé plus haut, a
donné de ce combat
un curieux récit.
D'après lui,
Charette, après
avoir tenté de
s'échapper par
l'Herbergemént, dans
la direction de
Saint-Fulgent, avait
perdu les 2.000
hommes qui lui
restaient: il n'en
avait plus que 39
quand il revint du
côté où l'attendait
Travot.
Charette, la nuit,
se présente, mouillé
jusqu'aux os, dans
une maison des Lucs.
Il se sèche auprès
du feu, sur un banc
de bois, et fait son
dernier repas d'un
œuf. La petite
troupe, grossie du
fils de la maison,
se glisse jusque
dans le petit bois
de la Chaboterie.
Elle y est depuis
peu, quand on
signale les Bleus.
Les 40 hommes se
précipitent avec
l'énergie du
désespoir : 8
traversent les
républicains et
s'échappent. Mais
Charette, atteint
d'une balle qui lui
a labouré le front
et couvert le visage
de sang, se jette
dans un fossé, s'y
blottit avec l'un de
ses fidèles...
Quelques grenadiers,
restés en arrière,
se présentent pour
passer le fossé
juste à l'endroit où
il était resté
caché. Se voyant
découvert, le
général se lève et
se nomme. Son
compagnon, debout en
même temps, ne veut
pas être pris
vivant. D'un coup de
fusil il abat le
soldat qui met la
main sur Charette et
tombe aussitôt percé
de coups. (De
Béjarry. - Souvenirs
Vendéens).
(3) Jeannet
Bauduère, l'un des
deux chasseurs de
Vendée qui
contribuèrent à
capturer Charette
dans le bois de
l'Essart, près la
Chaboterie, le 3
germinal, an IV (23
mars 1796), était
fils d'un huissier
du cabinet du duc
d'Orléans, alors
qualifié duc de
Chartres, comme
gouverneur du
Poitou. Il avait
succédé dans cette
charge, qui
consistait
principalement en
fonctions
d'appariteur, à Jean
Veillon seigneur de
Boismartin. L'autre
chasseur, le citoyen
Colombière, était
frère du citoyen
Mercier Vergerie,
qui, après avoir été
commissaire du
Directoire près le
tribunal civil et
criminel de la
Vendée, devint
député du
département au corps
législatif de
l'Empire.
Dugast-Matifeux,
Echos du Bocage
vendéen, année 1884,
pages 135 et 136.
(4) Darmaing, 476.
CONTINUATION DE LA
GUERRE. - MORT DE
VASSELOT HÉROIQUE
DÉFENSE DU CHÂTEAU
DE SAINT-MESMIN
Néanmoins sur divers
points de la Vendée
on luttait encore
désespérément.
D'Autichamps, le
nouveau
généralissime,
rallie quelques
soldats de Stofflet.
Vasselot et Grignon,
voulant tenter une
diversion avec une
troupe de neuf cents
hommes, battent les
Bleus à
Saint-Michel-Mont-Mercure,
aux Epesses et à
Saint-Laurent-sur-Sèvre
et essayent de
surprendre Fontenay
; mais le 30 mars,
atteints par des
forces supérieures
aux environs de
Chantonnay, ils sont
dispersés après six
heures de combat et
écrasés de nouveau
le lendemain, près
de
Saint-Vincent-Sterlanges.
Quelques jours
après, Vasselot,
errant sous un habit
de paysan, est
arrêté dans une de
ses fermes près de
Saint-Amand, conduit
aux Herbiers (avril
1796) et condamné à
mort par une
Commission militaire
présidée par les
généraux Beauregard
et Monet. Il est,
par un raffinement
de barbarie, fusillé
dans la cour du
château de
Mesnard-la-Barotière,
sous les yeux de sa
fiancée, Mlle de
Mesnard (4 mai
1796).
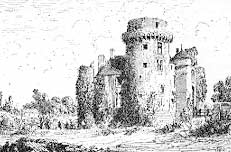
Tour de Saint-Mesmin
Quelques jours
après, Forestier, à
la tête de
cent-trente
fantassins et de
vingt cavaliers se
précipite en aveugle
sur le bourg de
Cirières, défendu
par quatre cents
républicains. Il y
est blessé et ses
soldats se
dispersent. - Vers
la fin d'août
quarante jeunes gens
des environs de
Cerizay, repoussés
par des forces
supérieures, se
jettent dans le
vieux château de
Saint-Mesmin, et là,
pendant trois jours,
manquant de pain et
d'eau, ils luttent
héroïquement contre
plus de quatre mille
hommes pourvus de
deux pièces de
canon, et ne
capitulent qu'avec
les honneurs de la
guerre. Quand les
Bleus virent sortir,
ayant à leur tête le
garde-chasse Péault,
de Saint-Mesmin, une
garnison de quarante
jeunes paysans,
noirs de poudre,
harassés de fatigue,
mais fiers encore de
la lutte qu'ils
venaient de
soutenir, ils ne
purent retenir leur
admiration, car ils
s'étaient figurés
avoir affaire au
moins à un millier
d'hommes.
C'était toujours de
l'héroïsme, mais de
l'héroïsme perdu
(1).
(1) Certains
historiens,
notamment MM. L.
Audé et Bourgeois,
Henri, placent cet
événement à la date
du 23 février 1896.
M. Bourgeois en a
publié un récit fort
intéressant dans La
Vendée Historique du
5 août 1901.
ÉTAT DES ESPRITS A
LA FIN DE MAI 1796
LETTRE DE HOCHE
TOURNÉE DE LE
TELLIER
ORGANISATION
DES CANTONS
La mort de Charette
et de Stofflet avait
consommé la ruine du
parti royaliste en
Vendée. -
D'Autichainps fait
sa soumission, et
l'abbé Bernier songe
à exploiter la
sienne. N'ayant plus
autant d'influence
sur les Blancs, il
en prend sur les
Bleus, à qui il
persuade que lui
seul peut compléter
l'œuvre de Hoche.
Mais ne jugeant pas
l'heure arrivée
encore, il feint de
gagner la frontière,
et il reste caché
dans l'Anjou,
pendant que Hoche
poursuit de plus en
plus l'œuvre de
pacification.
ARMÉE DES COTES DE
L'OCÉAN
Res, non verba,
Au quartier général
de Rennes, le 21
prairial, 4e année
républicaine (9 juin
1796).
Le général en Chef,
A l'Administration
départementale de
Fontenay-le-Peuple.
Citoyens
administrateurs,
En accordant aux
chefs des rebelles,
connus sous le nom
de Chouans et de
brigands, le pardon
de leurs fautes et
l'oubli de leurs
erreurs criminelles,
le Directoire a
aussi entendu qu'ils
rentreraient en
possession de leurs
biens, meubles et
immeubles, et
qu'enfin les
séquestre et scellés
apposés sur iceux,
devraient être
levés. Je dois donc,
citoyens, vous
engager à prendre
cette mesure, tant
pour voir les
instructions du
gouvernement
remplies, que pour
prouver aux
amnistiés que la
République forte de
ses propres moyens,
peut se passer des
secours que lui
procureraient leurs
biens, et qu'elle
les admet au nombre
de ses enfants.
Mais, dans aucun
cas, ces mesures
paternelles ne
peuvent être ni
appliquées, ni
applicables aux
Emigrés :
quiconque a quitté
illégalement le
territoire de la
République, en est
banni pour jamais,
aucun espoir ne doit
lui rester, il ne
peut attendre que la
mort. Tel est
l'esprit des lois
dont vous êtes les
organes ; je me
plairai toujours à
les exécuter
strictement.
Signé : L. HOCHE
(1).
Pour copie conforme,
Le Gal de division,
chef de l'état-major
de l'armée
T. HÉDOUVILLE.
C'est au milieu de
cette accalmie dans
les esprits que le
A. F. Le Tellier
adresse des «
Instructions
préliminaires aux
habitants de La
Vendée, pour
l'organisation
républicaine de
cette contrée. »
Le
Tellier commence sa
première tournée le
15 juin, et réussit
à organiser les
administrations
municipales des
cantons de la
Caillère,
Mouilleron,
Pouzauges et La
Flocellière.
Dans une seconde
tournée du mois de
juillet, il en
organise trois
autres aux
Moutiers-les-Mauxfaits,
au Tablier, à La
Mothe-Achard, et
dans une troisième
tournée, au
commencement du mois
d'août, quatre
encore à
La Roche-sur-Yon, La
Chaize, Beaulieu et
Landevieille.
Caillaud, un des
lieutenants de
Charette, évadé des
prisons de Saumur
vers la fin de
décembre 1796 (2),
demande au général
Travot et obtient
l'autorisation de
rentrer auprès de sa
famille en
s'engageant à
respecter les lois
de la République.
Malgré l'opinion de
l'abbé Brurnauld de
Beauregard,
ex-vicaire général
de Mgr de Mercy, la
présence des prêtres
réfractaires était
tolérée dans le
département, et au
cours de l'année
1797 jusqu'au 4
septembre (18
fructidor), un seul
prêtre, l'abbé
Clion, desservant de
la Gaubretière, fut
emprisonné « pour
avoir répandu des
bruits alarmants ».
Il comparut devant
le tribunal de
Montaigu qui
l'acquitta.
(1) Original,
collection Fillon,
communiqué par Mme
Charier-Fillon.
(2) Le 31 de ce
mois, le général de
Grigny, qui
commandait à
Montaigu, écrivait à
l'administration
départementale de la
Vendée en vue
d'obtenir son
concours pour la
création de six
compagnies de
vétérans nationaux
qui auraient élé
cantonnées à
Challans, Les
Sables, La
Roche-sur-Yon,
Montaigu, Les
Herbiers et La
Chataigneraie, mais
ce projet ne put
aboutir (Collection
Fillon).
LOI DU 14 BRUMAIRE
AN V (4 Novembre
1796) ÉLECTIONS DE
L'AN V
Aux termes de l'art.
4 de la loi du 14
brumaire an V, tous
les chefs rebelles
de la Vendée étaient
déclarés incapables
d'exercer aucune
fonction publique
élective ou à la
nomination du
pouvoir exécutif.
Cette mesure était
d'une grande
importance pour
éviter de nouveaux
soulèvements, car le
feu couvait toujours
sous la cendre ;
mais la situation
morale et
intellectuelle du
pays était telle que
la loi ne put être
appliquée, et que
les choses
demeurèrent en
l'état jusqu'à la
réunion des
assemblées
primaires,
L'assemblée
électorale du
département de la
Vendée ouvrit ses
séances dans
l'église N.-D. de
Fontenay, le 20
avril 1797, et les
continua jusqu'au
25, sous la
présidence de
Ambroise Rodrigue,
ancien évêque
constitutionnel. Les
cantons de Bouin, de
Poiroux, du. Poiré
et de Beaulieu,
foyers ardents de
l'insurrection,
n'envoyèrent pas
d'électeurs. Ceux de
l'île d'Yeu ne
purent arriver à
temps à cause de
l'état de la mer.
Maignen,
ex-conventionnel,
fut élu membre du
Conseil des Anciens,
et Chevallereau,
Jacques,
président de
l'administration
municipale du canton
de Luçon, fut envoyé
au. Conseil des
Cinq-Cents.
Pendant la même
session furent élus
les six juges au
tribunal civil du
département :
Rodrigue, le
ci-devant évêque de
Luçon ;
Esgonnière, déjà
juge ; Rouvière,
Menanleau,
d'Olonne ;
Rouillé et Fidèle Le
Mercier, avec
les juges suppléants
:
Beurrey-Chateauroux,
Henry père. Dubois,
Bichon et Cavoleau
(1).
(1) Chassin. - La
Pacification, T.
III, page 41.
NOUVELLES
DÉPORTATIONS DE
PRÊTRES
ARRESTATION
D'ANCIENS CHEFS
Les élus dont on
vient de voir les
noms étaient pour la
plupart des modérés,
désireux avant tout
de ramener la paix
dans leur pays ;
mais à Paris, on
s'inquiétait fort du
rôle prêté à
certains prêtres
réfractaires qui,
rentrés en Vendée, y
exerçaient le culte
sans avoir fait les
déclarations
prescrites par la
loi du 7 vendémiaire
an VI (28 septembre
1797), à l'époque où
la loi du 18
fructidor avait été
promulguée dans le
département.
Sur les instructions
du ministre de la
police générale,
Sotin, 14 prêtres
sont, par arrêtés
directoriaux,
désignés pour être
déportés, et, comme
des indices semblent
annoncer un
mouvement
insurrectionnel dans
la partie de
Châtillon et de
Montagne, le 25 mars
1798, la police
reçoit l'ordre
d'arrêter seize
individus plus ou
moins compromis dans
les troubles
extérieurs. Dans ce
nombre figurent
Forestier,
ex-commissaire
général de l'armée
du Centre à la
Gaubretière,
Saint-Pal au
Tablier, Caillaud
ex-chef, les frères
Savin, Dabbaye, etc.
C'est au milieu de
cette agitation
qu'eurent lieu à
Fontenay, le 9 avril
1798, les élections
des nouveaux membres
au Conseil des
Cinq-Cents,
Gaudin, Loyau,
Gilaizeau, Chaigneau
et Goupilleau.
Moins de vingt jours
après (28 avril
1798), Coyaud,
commissaire,
adressait au
ministre de la
police générale
l'état nominatif des
individus arrêtés et
détenus à
Fontenay-le-Peuple
par mesure de sûreté
générale. Sur les
21, huit furent le
14 mai remis en
liberté ; c'étaient
Saint-Pal, Davy,
Rabillier, Buor,
Guyet, Savin, Barbot
et Caillaud. Et
comme si la paix fut
revenue complètement
dans le pays, les
fêtes recommencèrent
à Fontenay.
SOULÈVEMENT DE 1799
Hélas ! ce n'était
qu'une éclaircie
dans un ciel chargé
d'orages. Le
Directoire avait
l'esprit trop étroit
pour comprendre la
grandeur et
l'habileté du plan
de Hoche qui voulait
pour la Vendée une
administration
spéciale - mi-partie
de réfugiés
patriotes et
d'habitants
indigènes. - Il
prolongea les
troubles fomentés
par les émigrés en
abandonnant la
Vendée aux
tracasseries de
patriotes exaltés.
En 1799, le marquis
de la Boëssière
conçoit un plan
formé sur celui de
Hoche et qui eût
gravement compromis
la pacification,
s'il eût été appuyé
par les monarchies
étrangères. Au même
moment une simple
menace de
conscription allait
rallumer la guerre
dans quelques
paroisses, où le
choix fait par les
électeurs de la
Vendée (9 avril
1799) de Dillon,
ancien prêtre
renégat, avait
irrité beaucoup de
bons esprits, et
donné une sorte
d'organisation aux
soulèvements, que
dès le mois de
février on annonçait
dans les régions de
Montaigu, les
Herbiers, l'île
d'Yeu et
Saint-Hilaire-de-Riez.
Vers la fin de juin,
Forestier, Renou des
Aubiers, Grignon et
Beauvolliers, à. la
tête de huit cents
Vendéens, attaquent
et
mettent en déroute à
Morveau le général
Delaage. Le 4
juillet Forestier
s'empare des
Herbiers. La ville
est livrée au
pillage et plusieurs
gendarmes assassinés
près du
Boistissandeau. Le 5
Tiffauges a le même
sort, puis quelques
jours plus tard la
Bruffière. Les
régions de
Saint-Michel-Mont-Mercure
et de la Flocellière
sont terrorisées
pendant que la
flotte anglaise est
en vue des côtes de
St-Gilles-sur-Vie.
Le 28 septembre,
d'Autichamps dans
l'Anjou et le
Haut-Poitou, Grignon
dans le pays de
Sapinaud, et
Suzannet (1) dans
celui de Charette,
instruits des succès
remportés sur la
rive droite de la
Loire par Georges
Cadoudal, Frotté,
Bourmont, Chatillon
et d'Andigné, lèvent
définitivement
l'étendard de la
révolte, et se
voient, bientôt à la
tête de quinze mille
hommes.
Le 20 octobre, les
Brigands entrent
dans Nantes d'où ils
sont chassés, il est
vrai, mais la
capitale de la
Bretagne, qui n'a
que sa garde
nationale pour la
défendre, demande
des secours à
Travot, obligé au
même moment de
diriger des troupes
sur Machecoul et
Port-Saint-Père (2).
Des rassemblements
sont signalés à
Saint-Laurent-sur-Sèvre,
à Rocheservière, a
Saint-André-Goule-d'Oie,
à Chantonnay, où
l'ex-député Girard
Villars, après avoir
été malmené, voit sa
maison livrée au
pillage. Caillaud
sort de sa retraite
et forme des
attroupements dans
les cantons de
Mareuil, Bournezeau,
La Chaize. D'autres
chefs prêchent la
révolte dans les
régions du Poiré,
Palluau, les
Essarts, les
Herbiers, Pouzauges,
La Flocellière.
Pendant quelques
jours tout fait
craindre une
nouvelle
insurrection
générale, mais grâce
aux mesures prises,
tout se borne à
quelques
échauffourées sans
grande, importance.
Dans les premiers
jours de novembre,
la division de
d'Autichamps est
battue aux Aubiers
pendant que
Suzannet, qui avait
rallié les cantons
de Légé, Palluau,
Belleville, etc.,
s'emparait des Lucs
et marchait sur
Montaigu avec neuf
cents hommes, mais
il fut battu et,
blessé devant cette
petite ville,
défendue par une
forte garnison et
plusieurs pièces
d'artillerie.
Ces deux combats
furent les dernières
lueurs du vaste
embrasement, qui,
depuis bientôt huit
ans, dévorait la
malheureuse Vendée.
Grignon, campé à
Chambretaud, avait
été surpris et tué
par les Bleus (18
novembre 1799),
Gogué, battu près de
Clisson.- Suzannet
était hors de
combat, et
Lecouvreur, écrasé
entre le Poiré et
Palluau, avec les
restes de la bande à
Grelier, n'avait
plus avec lui que
des malades et des
blessés (3). La
police du Directoire
(4) et Madame de
Turpin-Crissé
allaient achever
l'ouvrage des
successeurs de
Hoche, lorsque le 18
brumaire changea la
face des choses, en
élevant Bonaparte
sur le pavois.
(1) De Suzannet
Constant, né en
1772, au château de
la Chardière, près
Chavagnes-en-Paillers,
cousin de La
Rtochejaquelein,
avait été à l'école
militaire de Sorrèze
puis officier aux
gardes françaises.
Emigré, il avait
fait la campagne de
1792 à l'armée des
princes, et était du
régiment d'Hervilly
à Quiberon, Echappé
au désastre, il
gagna le pays de
Charette, et prit
part à la fin de la
deuxième guerre.
S'étant soumis, il
fut expatrié en
Suisse, d'où il
rentra à Paris peu
avant le 18
fructidor, an V.
Après le coup
d'État, il fut
arrété deux fois
avec d'Andigné, mais
il put s'échapper de
sa prison, d'où il
gagna l'Angleterre,
où il continua les
agissements qui
amenèrent la 3e
guerre de l'Ouest en
1799-1800. Il fut
blessé dans un
combat près de
Montaigu, puis
emprisonné. Relâché
de nouveau, il entra
dans la conspiration
de Georges Cadoudal,
mais put s'enfuir en
Allemagne. L'un des
principaux chefs de
l'insurrection de
1814-1815, il l'ut
tué le 20 juin à
l'affaire de
Rocheservière.
(2) En rendant
compte de la prise
de Nantes, Travot
réclame instamment
de l'adininistration
centrale de la
Vendée des souliers
dont il e le plus
grand besoin.
(Lettre-collection
Fillon.)
(3) Il y eut bien
encore quelques
tentatives de
soulèvements
partiels, notamment
à Sallertaine, où le
11 janvier 1800, 600
rebelles furent
battus par Travot
mais ils furent sans
importance.
(4) Une lettre
des Herbiers, datée
du 19 vendémiaire,
an VIII (11 décem
bre 1799), signée
Oudard, donne de
curieux
renseignements à
Fouché, ministre de
la police, sur les
excès commis par des
émissaires du
Directoire,
transformés en faux
émigrés
(Crétineau-Joly,
tome I).
LE 18 BRUMAIRE, AN
VIII (9 Novembre
1800)
ROLE DE L'ABBÉ
BERNIER
ADMIRATION DU
PREMIER CONSUL POUR
LES VENDÉENS
A l'instant, tous
les yeux se
tournèrent vers cet
homme providentiel.
Les royalistes
rêvèrent un nouveau
Monk, et les
républicains un
nouveau Washington.
Ils se trompaient
les uns et les
autres. C'était un
nouvel
Octave-Auguste qui
allait dominer le
monde.

L'abbé Bernier
L'abbé Bernier fut
des premiers à
deviner « Napoléon
sous Bonaparte », et
il jugea le moment
venu pour le rôle
qu'il méditait
depuis si longtemps.
Bonaparte, de son
côté, sut apprécier
le talent et
l'ambition du curé
de Saint-Laud, qui
l'éclaira sur les
plaies les plus
tristes, comme sur
les plaies les plus
glorieuses de la
Vendée. L'héroïsme
des géants et la
faiblesse des
pygmées furent
également révélés
par cet homme qui
savait tout, et
grâce à
l'intervention
duquel un armistice
fut bientôt conclu.
L'assassinat du
comte de Grignon,
suivi du meurtre de
quatre Bleus,
entrava un instant
les négociations,
mais elles furent
reprises le 12
décembre, à Pouancé,
et le 26 du même
mois, d'Andigné
était reçu au
Luxembourg par le
premier Consul,
qu'il étonna par son
courage et sa
grandeur d'âme.
Cadoudal et Frotté,
qui triomphaient
encore en Bretagne,
jettent en vain leur
épée dans la
balance, Bonaparte y
jette aussi la
sienne, dont il
menace d'écraser la
Vendée... La paix
est enfin signée par
tous les chefs de la
rive gauche, à
Montfaucon, le 18
janvier 1800, et
l'abbé Bernier la
fait aussitôt
annoncer au prône
par tous les curés.
Il se laisse
lui-même enlever de
l'Anjou par le
général Bédouville
et Barré, et il
s'installe
magnifiquement près
de Bonaparte, en
pacificateur et
représentant naturel
de la Vendée et des
Vendéens.
Quelques mois après
Bonaparte ramenait
toute la France aux
idées de foi et de
monarchie. Il sentit
que s'il avait pu
réveiller ce double
sentiment, il le
devait à
l'insurrection de la
Vendée qui l'avait
défendu avec le
courage de la
Vestale antique. Il
proclama dès lors ce
peuple un peuple
de géants,
déclarant maintes
fois qu'il serait
fier d'être Vendéen.
- Une attaque des
Anglais contre
Noirmoutier offrit
au premier Consul
l'occasion depuis
longtemps cherchée
de dire toute son
admiration pour les
héros d'une cause
qui n'était pas la
sienne, mais dont il
respectait la
grandeur.
ATTAQUE DE
NOIRMOUTIER PAR LES
ANGLAIS
Le 28 juin 1800,
raconte Piet dans
ses Recherches
sur Noirmoutier,
une division
anglaise de quatre
vaisseaux, une
frégate et un
cutter, apparaît
devant Noirmoutier
et tente de
s'emparer de
quarante bâtiments
chargés de grains
pour Bordeaux... Le
30, la tentative se
renouvelle. On peut
craindre un
débarquement. Le
commandant d'armes,
Solin-Latour, ancien
capitaine
d'infanterie aux
colonies, s'adresse
au maire Piet, pour
combiner la défense
de l'ile. La force
armée consistait en
une compagnie
franche, formée
d'une soixantaine de
jeunes gens des
Sables et de
Noirmoutier et en
quelques canonniers,
que
cornmandait
Julien-Aimé Viaud...
Vers six heures du
soir, quinze à vingt
chaloupes se
détachent des
vaisseaux anglais,
et la nuit, à la
marée montante,
entrent dans le
Gois... Le brick
stationnaire répond
bravement à
l'attaque, mais trop
faible, est pris.
Les Anglais se
rapprochent du
convoi de grains et
en peuvent incendier
la majeure partie.
Comme la marée
baissait, ils
devaient hâter leur
retour. Leurs
embarcations, étant
venues s'échouer, à
la portée des
batteries de
Barbâtre, sont
canonnées. Le
bouillant
Solin-Latour se
précipite dans le
Gois avec sa petite
troupe et
l'artillerie. Il
force les Anglais à
abandonner leurs
péniches et leur
fait quarante-deux
prisonniers.
Cinquante autres,
craignant de se
perdre sur le sable
mouvant, se rendent
un peu plus loin aux
douaniers.
La rentrée de la
troupe avec les
prisonniers et les
armes saisies sur
les péniches
transporte
d'enthousiasme les
habitants de
Noirmoutier. Les
blessés ennemis sont
déposés à l'hospice
civil, les
prisonniers valides
dans la salle du
château ; tous
traités avec la plus
grande humanité. Le
soir même, un des
officiers de la
frégate anglaise
vient proposer, au
nom de sir Warren,
l'échange des
prisonniers contre
un nombre égal de
marins de l'île,
détenus en
Angleterre. Solin
veut refuser ; Pieu
accepte et règle les
conditions, sauf
ratification par le
général commandant
la division... La
convention devant
suivre ; la filière
administrative, il
fallut quatre mois
pour opérer
l'échange.
Ce petit fait
d'armes, auquel
prirent une certaine
part, de l'autre
côté du Gois,
quelques habitants
de Beauvoir, ayant à
leur tête le
lieutenant de
gendarmerie Mourain,
donna lieu à
plusieurs rapports
qui furent mis sous
les yeux du premier
Consul.
Bonaparte, ainsi que
nous l'avons déjà
dit, saisit cette
occasion « de
détacher les
Vendéens du parti
royaliste. » Il
chargea le préfet
Lefaucheux de
féliciter les braves
habitants qui
avaient repoussé les
Anglais et d'en
envoyer douze à
Paris.
« Si, disait-il,
parmi ceux qui se
sont distingués, il
y a des prêtres,
envoyez-les de
préférence ; car
j'estime et j'aime
les prêtres qui sont
bons Français, et
qui savent défendre
la patrie contre les
éternels ennemis du
nom français, ces
méchants hérétiques
d'Anglais ! »
Les douze Vendéens
furent présentés le
16 fructidor, an
VIII (3 septembre)
aux consuls, aux
ministres et
conseillers d'État
assemblés, par le
ministre de
l'Intérieur et le
général Hédouville.
L'un de ces braves
remit au secrétaire
la lettre d'un des
prêtres du pays qui
avait contribué avec
eux au succès de
l'action et assura
le premier Consul de
la bonne conduile de
ce prêtre et de ses
confrères.
Bonaparte, d'après
l'avis de
l'assemblée, donna
ordre que l'on admit
de suite au Prytanée
un enfant de chacun
de ceux qui, parmi
ces défenseurs de la
patrie, se
trouvèrent être père
de famille (1).
Ces Vendéens furent
logés à Paris, dans
un hôtel magnifique,
et après l'audience
des Tuileries, on
les envoya à
l'Opéra. Tous, avant
de partir, reçurent
une carabine
d'honneur, outre des
frais de voyage
magnifiques. Rentrés
chez eux, ces braves
gens croyaient avoir
rêvé : croyant être
le jouet d'une
hallucination, œuvre
du démon, ils se
signaient, terrifiés
au nom seul de celui
qui fut plus tard
l'Empereur (2).
On sait aussi tous
les efforts que fit
Napoléon pour
emprunter à la
Vendée ses généraux
royalistes. Pas un
ne se rendit alors à
ses séductions : -
il faut le dire à
l'honneur de leur
fidélité, le curé de
Saint-Laud les en
sollicita en vain
(3).
En 1801, vint le
Concordat,
chef-d'œuvre de
pacification, dans
lequel la Vendée eut
sa grande part.
Bonaparte, du reste,
le reconnut
publiquement en
faisant représenter
la France catholique
par ce même abbé
Bernier qui avait
soulevé les premiers
Vendéens autour de
la croix (4).
(1) Chassin. - La
Pacification de la
Vendée, page 650.
(2) Une vieille
estampe du temps
(Basset, rue
Saint-Jacques,
Paris), retrace
cette entrevue du
puissant Consul avec
les Vendéens, dont
six de Noirmoutier,
qui avaient noms
Julien-André
Lassourd, Sébastien
Palvadeau, Jean
Pénisson, François
Boulet, Isidore
Milsent et Mathurin
Porchais. -
(Viaud-Grand-Marais,
Guide du Voyageur â
Noirmoutier, page
59).
(3) En 1805,
l'Empereur offrait
au paysan Forestier,
le premier promoteur
de la révolte de
Saint-Florent-le-Vieil,
toutes ses faveurs ;
le jeune Vendéen les
refusa comme une
offense. Il mourut
en 1808, âgé de 34
ans. - La même
année, on vint
offrir à. Louis de
la Rochejaquelein,
frère de Henri, une
place à la cour, en
lui disant de se
mettre à prix. - En
1809, on voulut le
forcer à entrer dans
l'armée avec le
grade de colonel. -
La même année, son
frère était
incorporé de force
dans l'armée
impériale. A la
bataille de la
Moskowa, il fut
couvert de
blessures, fait
prisonnier et
conduit à Saratow.
Ils étaient encore
nombreux à cette
époque mémorable,
les chefs
royalistes, et nous
les verrons bientôt
reparaître dans la
campagne de 1815. -
Dans l'armée du
Centre il restait le
général de Sapinaud,
Auguste de Béjarry
et son frère Amédée,
négociateur du
traité de La Jaunais
Ussault, de
Braucourt, et parmi
les chefs
secondaires de la
Grande Armée l'abbé
Jagault et MM. d'Autichamps,
les trois Soyer, de
Beauvolliers,
Allard, le chevalier
de Chantreau, de la
Voyrie, Texier de
Courlay, etc. Dans
l'armée du Marais,
il ne restait que
MM. de Bruc,
Hyacinthe de La
Roberie, qui avait
été l'aide-de-camp
de Charette,
Caillaud, Desabbayes,
Lecouvreur,
Desnorois et Gatet,
officier de
cavalerie.
(4) Cette grande
affaire s'engagea le
9 novembre 1800, par
la présentation aux
Tuileries de
l'envoyé du Pape.
Les termes en furent
définitivement
arrètés à Paris, le
26 messidor, an X
(15 juillet 1801) et
acceptés par le
Pape, à Rome, le 15
août. Les
ratifications furent
échangées le 11
septembre suivant,
sous les signatures
suivantes : les
Conseillers d'Etat,
Joseph-Bonaparte et
Emmanuel Cretet, et
le curé de
Saint-Laud d'Angers,
Etienne Bernier,
pour la France ; le
cardinal-secrétaire
Consalvi,
l'archevêque de
Corinthe, Spina et
le Père Casselli,
général de l'Ordre
des Servants de
Marie, pour le
Saint-Siège.
LE CONCORDAT ET LA
PETITE ÉGLISE
Le Concordat
engendra toutefois
en Vendée un
schisme, dont la
trace n'est pas
encore complètement
disparue
aujourd'hui. Parmi
les évêques émigrés
dont le Pape réclama
la démission,
trente-huit la
refusèrent et
quelques Vendéens
doutèrent de
l'infaillibilité du
pape Pie VII.
Ceux qui refusèrent
le Concordat
formèrent la
communion appelée
La Petite Eglise
(1). En vain, sur
les trente-huit
évêques dissidents,
trente-six se
soumirent aux
prières du Saint
Père : MM. le Coucy
et de Thémines,
évêques déchus de La
Rochelle et de
Blois, restèrent les
seuls et vrais
pasteurs des
adversaires du
Concordat.
L'abbé Bernier
lui-même, devenu
évêque d'Orléans, se
flatta de rallier
ces derniers par sa
présence. Il fut
reçu en triomphe
dans tout le Bocage,
mais il se vit
insulté publiquement
et secrètement à
Angers. Des lettres,
pleines d'injures,
des bouteilles
pleines de sang lui
furent adressées de
toutes parts, et il
fallut écarter de
son passage la
population
furibonde. Désolé,
il regagna son
diocèse et y
chercha, dans
l'accomplissement de
ses devoirs
sacerdotaux, l'oubli
de ses douleurs et
peut-être de ses
remords, reçut un
coup fatal en 1803,
en apprenant qu'on
l'avait oublié dans
la promotion des
cardinaux et mourut
enfin en 1806, à
quarante-deux ans,
d'un accès de fièvre
et d'ambition, -
après une entrevue
fâcheuse avec
l'Empereur.
(1) Le chef-lieu de
la Petite Eglise est
actuellement à La
Pennelière de
Courlay
(Deux-Sèvres), où
existe un temple
pouvant contenir
huit cents
personnes. On y
montre avec
vénération divers
objets fabriqués par
un ancien menuisier
de Fontenay, du nom
d'Aubin, ou lui
ayant appartenu. |