|
Beaupuy se flattait,
: la Vendée n'était pas morte, et la
guerre m'était point terminée : la
République qui le 26 décembre
offrait à Nantes des couronnes
civiques aux vainqueurs de Savenay,
avait encore à écraser des débris
palpitants, et à vaincre deux géants
dans toute leur force :
Charette et la
Chouannerie.
Suivons d'abord jusqu'à la tombe ou
jusqu'à l'échafaud les derniers
chefs de la Grande-Armée.
Le prétendu évêque d'Agra fut
exécuté à Angers le 4 janvier 1794.
- Desessarts père fut fusillé à
Feygréac. - Pirot eut le même sort.
- Vingt autres aussi.
Le prince de Talmont, surpris
déguisé en paysan, était traîné de
prison en prison jusqu'à Laval, où à
l'âge de 28 ans il était décapité
devant le château de ses pères.
A peu de semaines de là Beysser et
Westermann, deux généraux
républicains intrépides, tous deux
Alsaciens et tous deux âgés de 40
ans, étaient aussi guillotinés comme
conspirateurs, et allaient bravement
au supplice bras dessus bras
dessous.
LA ROCHEJAQUELEIN ET STOFFLET, ETC.,
ERRENT SUR LA RIVE GAUCHE DE LA
LOIRE
Cependant La Rochejaquelein,
Stofflet, Laugerie et La VilleBaugé,
séparés de leurs soldats, comme on
l'a vu, erraient au hasard sur la
rive gauche de la Loire, faisant le
coup de feu contre les patrouilles
républicaines pour leur arracher un
morceau de pain Ils couchèrent une
nuit sans le savoir avec des bleus,
sur la même meule de paille. Henri
arriva enfin près de sa sœur à la
Durbelière, et médita dans ce court
repos ses dernières batailles
(1)...
(1) Extrait de Pitre-Chevalier.
EXPLOIT DE CHARETTE NOMMÉ GÉNÉRAL EN
CHEF DE LA BASSE-VENDÉE
SA RENCONTRE AVEC HENRI DE LA
ROCHEJAQUELEIN
La marche de l'armée vendéenne sur
la rive droite avait suspendu les
opérations du général Haxo clans la
Basse-Vendée (1). Le 9 novembre il
sort de Nantes avec 6.000 hommes,
chasse les royalistes de
Port-Saint-Père et de la forêt de
Princé (15 novembre), le lendemain
il est à Machecoul, où il installe
des fours de campagne, donne
quelques jours de repos à ses
troupes, se dirige de là sur
Challans, où, il trouve quelques
détachements ennemis qui doivent se
replier sur Beauvoir. Après avoir
établi à Challans des fours de
campagne comme à Machecoul et, fait
remettre les moulins à vent en état
de service, il donne au général
Jordy l'ordre de s'emparer de Bouin.
Le 6 décembre, à minuit, les trois
colonnes républicaines s'ébranlent,
arrivent sous les batteries de
Bouin, chargent baïonnette au canon
les Vendéens, qui après avoir perdu
800 des leurs, se sauvent avec
Charette par la route de
Bois-de-Céné.
A Chateauneuf ils rallient la
division Pajot, tombent à
l'improviste sur l'arrière-garde
d'Haxo, la mettent en déroute après
trois heures de combat et vont
chanter, dans l'église de
Saint-Étienne-de-Mer-Morte, un Te
Deum d'action de grâces.
De Saint-Étienne-de-Mer-Morte,
Charette se dirige vers le
Haut-Bocage, capture en route six
pièces d'artillerie, des vivres et
des chaussures, et le 8 décembre,
rejoint aux Quatre-Chemins-de-l'Oie
le général Joly, qui lui ouvre un
camp républicain de 2.000 hommes en
arborant la cocarde tricolore et en
égorgeant toutes les sentinelles.
Cette affaire laissait aux mains de
l'armée vendéenne d'abondantes
munitions, 45 chevaux, 1.500 fusils,
avec 11 voitures chargées de vivres,
etc. Le lendemain il est aux
Herbiers, où il est proclamé
généralissime de l'armée
catholique et royale de la
Basse-Vendée. Investi du pouvoir
suprême,. il organise ses forces,
laisse à Couëtus, à Joly et à Savin
leurs divisions, choisit Denis de
Norois pour chef d'état-major, de la
Roberie pour commandant en second,
et dirige au cœur de la Vendée
l'armée la plus aguerrie qu'on y eût
encore vue, grossie de tous ceux qui
pouvaient fuir les atrocités de
Carrier à Nantes. « Charette,
écrivaient en décembre 1793 Haxo et
Dutruy, nous a fait un mal horrible.
Ce brigand a trouvé le moyen de
déjouer la sagacité des plus habiles
manœuvriers. »
Le 15 décembre, la présence de
l'ennemi aux environs des Herbiers
ayant été signalée au général
Vimeux, ordre est donné de fouiller
le pays depuis le Luc jusqu'aux
Épesses. Les généraux Dufour et
Guillaume sont chargés de cette
mission. Le 18, la colonne de ce
dernier entre dans Montaigu pour y
prendre des vivres et, dès le matin,
met en trois endroits le feu à la
ville. Charette, pressé du côté du
Grand-Luc, se porte vers la
haute-Vendée pour favoriser le
passage de la Loire aux Vendéens
échappés au désastre du Mans. Il
surprend, dans la nuit du 18 au 19
décembre, le poste de Cerizais,
parcourt et dévaste la Flocellière,
la Pommeraye, le Boupère, Pouzauges
et Châtillon, et traverse de
nouveau, le 23 décembre, le poste
des Quatre-Chemins. Le 29, le
partisan devenu général rencontre à
Maulévrier La Rochejaquelein, le
général redevenu soldat. Celui-ci
confirme à Charette la destruction
de la Grande-Armée, et par sa seule
présence lui enlève des milliers de
soldats.
(1) Depuis le siège de Nantes,
Charette avait poursuivi la guerre à
sa façon, franchissant à la gaule
les fossés des marais de Challans,
de Bouin, de Machecoul, de
Saint-Jean-de-Monts, et traînant à,
bras ses canons et son matériel,
empéchant les massacres lorsqu'il le
pouvait, et fermant les yeux
lorsqu'ils étaient inévitables,
déployant en un mot une volonté
surhumaine, dans une guerre de
détail si bien faite pour lui.
MÉSINTELLIGENCE DES CHEFS. -
NOUVEAUX COMBATS DE CHARETTE
Encore une fois il fallait s'unir :
encore une fois l'intérêt commun fut
oublié !... « Suivez-moi, monsieur,
dit Charette à La Rochejaquelein. »
- « Monsieur, répondit La
Rochejaquelein, je ne suis pas
habitué à suivre, mais à être suivi.
» Et il lui tourna le dos.
Charette, affaibli, quitta le Bocage
et regagna les Marais du Bas-Poitou.
Le 31 décembre il s'empare de
Machecoul, mais Carpentier l'en
chasse après deux combats furieux,
les 2 et 3 janvier 1794. Pendant que
Charette, rendu incapable de
secourir Noirmoutier, retourne à
Légé, son quartier général,
Carpentier occupe Challans pour
observer les mouvements de son
adversaire et l'empêcher de prendre
à revers les troupes destinées à
l'attaque de Noirmoutier, « cette
île qu'on doit, », d'après l'ordre
du Comité de Salut public du 21
octobre, « reprendre ou ensevelir ».
PRISE DE NOIRMOUTIER (3 Janvier
1794). - EXÉCUTION DE D'ELBÉE (9
Janvier 1794). -- LE COMBAT DE
MOUCHAMPS
Le 3 janvier, pendant que Turreau,
accompagné de Bouchotte et de Prieur
de la Marrie, établissait son
quartier général à
Beauvoir, puis à la Barre-de-Monts,
les généraux Haxo et Dutruy
attaquèrent Noirmoutier occupé par
dix-huit cents royalistes, dont huit
cents bien armés, commandés par
Pineau, de Légé, Antoine, Savin,
Barreau, Noël, l'Irlandais O'Birn,
etc. René de Tinguy, ancien
sous-commissaire de la marine, était
gouverneur de l'île au nom de Louis
XVII.
Les côtes et la place Saint-Pierre
étaient défendues par cinquante
bouches à feu dont plusieurs de gros
calibre, et par des marais salants
qui en rendaient les avenues
étroites et difficiles. Les
républicains n'avaient que trois
mille hommes d'élite, avec une
flottille composée d'une frégate, La
Nymphe, et de dix-neuf bâtiments de
transport. Les assiégés pointent une
pièce de trente-six sur la frégate
et la font échouer ; mais tout
l'équipage se sauve à marée basse.
Le général Jordy est blessé, à la
cuisse ; cent hommes sont tués sur
le bâtiment de transport monté par
cet officier... Haxo, de son côté,
traverse le passage du Gua au pas de
charge, s'empare de Barbâtre, et
s'avance sur Noirmoutier où la
terreur est à son comble. La ville
capitule, et d'Elbée arrêté avec
trente des principaux chefs (1).
Mourant depuis la bataille de
Cholet, il dut, subir un long et
pénible interrogatoire. - « Voici
donc d'Elbée ? s'écria le
représentant Bourbotte en
l'apercevant ». - « Oui, reprit
d'Elbée, voilà votre plus grand
ennemi ! si j'avais pu me tenir
debout, Noirmoutier ne serait pas en
votre pouvoir, ou du moins vous
l'eussiez chèrement acheté ! »
Le 9 janvier 1794 il était fusillé
dans son fauteuil avec René de
Tinguy, Duhoux d'Hauterive, de
Boisy, et Wieland, ancien chef des
bataillons les chasseurs de la
Manche, qui avait rendu l'île à
Charette le 12 octobre 1793.
Madame d'Elbée, qui avait noblement
refusé de quitter son mari, périt le
lendemain avec Mme Maurin, qui lui
avait donné l'hospitalité dans sa
maison et qui avait partagé son
dévouément. Pineau, Antoine Savin et
beaucoup d'autres eurent le même
sort.
Le « rasoir national » décima enfin
toute la population (2) de l'île de
Noirmoutier, qu'on appela l'île de
La Montagne.
Le 9 janvier, au moment où d'Elbée
mourait à Noirmoutier, Charette,
poursuivi par le général Dutruy,
arrive aux Herbiers où 3.000 hommes
l'attendent : avec ces renforts il
marche sur Saint-Fulgent. La
garnison se retire à Mouchamps, sur
le Petit Lay ; son colonel, Joba, y
bivouaquait avec son régiment et
deux escadrons de cavalerie. On se
battit avec acharnement, et la
victoire fut si incertaine que les
deux partis se retirèrent avec des
pertes égales.
(1) Ce jour-là, l'île de Noirmoutier
changea son nom contre celui d'île
de la Montagne et l'île de Bouin
s'appela l'île Marat.
(2) Des documents très curieux sur
ces faits existaient à Noirmoutier
il y a quelques années encore ; ils
furent brûlés, dit-on, par le maire,
qui les trouvait beaucoup trop
compromettants pour certaines
familles de l'île. (Profils
Vendéens, p. 151). - Voir aussi
dans la Revue du Bas-Poitou,
11° année (1898), pp : 257-267, un
remarquable article de d'Elbée,
intitulé : La mort de d'Elbée.
- La commission militaire. Le
fauteuil dans lequel fut fusillé
d'Elbée à figuré à l'exposition
ethnographique de Niort en 1896. -
Les historiens ne sont pas d'accord
sur la date exacte de la mort de
d'Elbée, non plus que sur le rôle de
Dutruy.
LES COLONNES INFERNALES
La Convention, qui a
changé le nom du département de la
Vendée, en celui de Vengé,
qui a supprimé le culte religieux
dans tout le pays occupé par les
troupes républicaines, qui a
applaudi à l'envoi des lettres de «
déprêtrisation » de plusieurs
curés et à leur abjuration (1),
organise alors, sur la proposition
de Turreau, les fameuses Colonnes
infernales (2). Douze camps
retranchés, composés de soixante
mille hommes occupent les meilleurs
postes du Bocage, enveloppent et
affament la Vendée entière, et
lancent de toutes parts des troupes
sans artillerie ni bagage, chargées
littéralement de
tout brûler et de tout massacrer.
Le général
Grignon, l'ancien boucher, ouvre
la marche en disant à ses soldats :
- « Je sais bien qu'il peut y avoir
des patriotes dans ce pays...! C'est
égal, nous devons tout immoler !
Les commandants, où plutôt les
bourreaux des onze autres colonnes
étaient
Huché, Du four, Caffin, Amey,
Charlery, Beaufranchet, Chalbos,
Gramont, ancien comédien, Cordelier,
Commaire et Dalliac.

Turreau
La consigne infernale fut si bien
remplie que Lequinio, qui l'avait
conseillée ; Lequinio lui-même
recula devant son œuvre : mais il
était trop tard (3).
Pendant un mois entier, à partir du
20 janvier 1794, la Vendée ne fut
qu'ut bûcher continuel et qu'un
cimetière immense (4).
Au premier coup de fusil annonçant
la Colonne infernale - «
Entendez-vous l'horloge de mort ? »
se disait-on de porte en porte. Et
saisissant les provisions dans la
mette, emportant les malades et les
enfants, détachant les bestiaux de
l'étable, on s'enfuyait aux gites à
travers les genêts et les chemins
creux.
(1) Pour détails, voir La Vendée
patriote, de Chassin, tome III,
chap. XLII.
(2) Pour les Colonnes infernales,
voir notamment la Revue du
Bas-Poitou. (Année 1896), pages
424-432, etc., et la Vendée
historique, 1er et 2e années.
(3) Ses révélations devant le Comité
révolutionnaire de Fontenay sont
tellement épouvantables que nous ne
pouvons les reproduire ici. - Ce fut
le 28 mars 1794, que la Société
populaire et républicaine de
Fontenay donna le signal d'une pro
testation généreuse contre les
exactions des généraux incendiaires.
(4) Devaient, d'après l'ordre
général donné à Doué, le 30 nivose,
an II par Turreau, être exceptés de
l'incendie : Saint-Florent, Luçon,
Montaigu, La Châtaigneraie,
Sainte-Hermine, Machecoul, Challans,
Chantonnay,
Saint-Vincent-Sterlanges, Cholet,
Bressuire, Argenton et
Fontenay-le-Peuple. (La Vendée
patriote, tome IV, page 52).
LE REFUGE DE GRALA PRÈS LES BROUZILS
Sur quelques points
touffus, des populations entières
improvisèrent des villages à l'ombre
des forêts. Il y a quarante ans, on
voyait dans la forêt de Grala, près
les Brouzils, les restes d'un de ces
villages, - à l'endroit qui
s'appelle toujours
Le Refuge.
« De fortes branches attachées au
tronc des arbres formaient la
charpente des habitations. Les
murailles étaient figurées par
d'autres branches entrelacées de
feuillage et tapissées de gazon. -
Ces habitations étaient alignées à
droite et à gauche d'une sorte de
rue, pavée d'herbe épaisse. Le dôme
élevé de la forêt garantissait le
tout des intempéries de l'air.
Là, chacun avait transporté son
ménage, son trésor, ses bestiaux et
ses amours.. Les hommes y étaient
rares et travaillaient pour les
femmes ; les mères mettaient au
monde et élevaient leurs enfants. Un
prêtre réfractaire baptisait les
nouveau-nés, bénissait les mariages,
assistait les mourants et enterrait
les morts. - Tels sont la vie et le
cœur humain : les plaisirs même, les
jeux et parfois les danses du pays
revivaient dans cette colonie
proscrite. Mais surtout on y priait
pour les braves qui défendaient
encore la Vendée... car à chaque
coup de canon tiré dans le lointain,
que de femmes et d'enfants
tremblaient pour leurs époux, leurs
fils et leurs pères ! On avait des
courriers adroits et intrépides, des
vieilles mendiantes ou des petits
gars, qui, leurs sahots à la main,
courbés dans les chemins creux,
filant comme des lièvres dans les
genêts, allaient savoir des
nouvelles de l'armée et du
village... Ils ramenaient souvent un
soldat paysan fugitif ou blessé...
Alors que de questions et de soins,
et que de terreurs ou d'espérances
dans tout le refuge !
Telle était la vie de ceux
qu'épargnait la mort... Cependant
les Colonnes infernales achèvent
leur mission. Huché a tout brûlé et
tout tué du Port-la-Claye à
Sainte-Hermine. - Dufour au district
de Montaigu (1). - Cordelier, de
l'est à l'ouest. - Grignon, dans le
sens contraire,
d'Argenton-le-Château aux
Herbiers... Il n'y a plus qu'un
désert fumant de Clisson au Loroux,
de Tiffauges à Vezins, dans tout le
Haut-Poitou et dans une partie de
l'Anjou. Plus d'un quart de la
population est mort ; le reste est
disparu. Deux cent mille bestiaux
ont péri avec leurs maîtres. Ce
qu'on a brûlé de fourrages, de bois
et de blé est incalculable. Les
chiens de fermes hurlent sur les
décombres, attendant un Vendéen pour
le caresser ou un Bleu pour lui
sauter à la gorge.
Faut-il blâmer après cela les
paysans qui se vengèrent sur les
patriotes ? Mais il avait été donné
à un seul homme, à Carrier, dont
nous ne raconterons point les
sinistres exploits, de dépasser les
abominations commises par les
Colonnes infernales (2).
(1) Dans la commune de Chavagnes,
dont l'église, le château de
l'Ulière et une partie du bourg
avaient été incendiés dans le mois
d'octobre 1793, plus de cent
personnes de tout âge et de tout
sexe furent massacrées le dimanche
23 février 1794, après des atrocités
sans nom. Ce lugubre événement est
connu dans le pays sous le nom de «
jour du grand massacre ». (Echos
du Bocage Vendéen, IIIe année,
pages 346 et 347.
(2) PitreChevalier, pages 508 et
509.
BEAU TRAIT DE DAVID D'ANGERS
Partout, il faut le dire, ces
bourreaux de la Terreur trouvèrent
des hommes assez généreux pour leur
disputer des victimes ; partout les
crimes et les dévouements se
multiplièrent les uns par les
autres. Nous citerons entre mille,
un trait fort touchant de David, le
père de Maxime David, l'excellent
peintre en miniature.
Louis David, alors âgé dé
vingt-trois ans, avait quitté le
service militaire par un honorable
scrupule. Il fut envoyé comme
contremaître à l'arsenal d'Angers.
Mieux valait encore, à ce temps-là,
forger les armes que les manier.
David recevait de la République un
maigre salaire, à peine suffisant à
sa laborieuse existence. Il logeait
dans une toute petite chambre, au
dernier étage d'une de ces vieilles
maisons d'Angers, dont les portes
sont si étroites et les couloirs si
sombres. Un soir il rentrait chez
lui : une charrette longeait la rue,
portant des Brigands à la
guillotine.... David s'arrête frappé
de terreur et de pitié... Toup à
coup un corps rapide le heurte, le
pousse dans le corridor et y
disparaît en le devançant.... David
monte à sa suite jusqu'au dernier
étage et trouve à la porte de sa
chambre une jeune fille éperdue, les
cheveux épars et les vêtements en
désordre : - « Sauvez-moi, monsieur,
lui dit-elle, au nom du Ciel,
sauvez-moi ! ... » David avait déjà
ouvert son modeste logement et mis
en sûreté celle qui l'implorait.
Elle lui dit alors : « Je suis
mademoiselle de l'Epine. Cette
charrette conduit toute ma famille à
l'échafaud ; j'en suis tombée par
miracle.... Un autre miracle m'a
jeté chez un homme de cœur....
Partagez avec Dieu ma reconnaissance
». David s'enferme avec la victime,
et attend en frissonnant pour elle
et pour lui-même. Personne ne monte,
et l'espérance succède à
l'effroi.... Mais ces angoisses
devaient se renouveler chaque
jour.... Qu'un des mille Argus de
Francastel eût le moindre soupçon,
et c'en était fait de la vile
Brigande et de son sauveur.... David
garda ainsi mademoiselle de l'Épine
pendant six semaines. Il la quittait
le matin pour aller à l'arsenal, et
revenait après son travail en
partager le fruit avec elle.... Nous
avons dit qu'il avait à peine de
quoi vivre.... Quand le dîner ne
suffisait pas pour deux, s'était lui
qui s'imposait les privations. Le
sacrifice qui lui coûta le plus fut
celui de son lit. Huit jours durant,
toutefois, il le céda à la jeune
fille, et non moins respectueux que
dévoué, il dormait près d'elle sur
une chaise. Mais un tel repos, après
les fatigues du jour, altéra sa
santé.... Or, s'il fût tombé malade,
lui et sa compagne étaient perdus
!... « Mademoiselle, lui dit-il un
soir, vous avez assez éprouvé ma
discrétion ; accordez-moi une grâce
d'où dépend notre salut commun.
Permettez-moi de réparer ma force
épuisée en reprenant la moitié de
mon lit. »
Et désormais, le jeune homme et la
jeune fille, sans reproche comme
sans défiance, dormirent côte à côte
et tout habillés sur
le même matelas.... Un jour enfin,
ils sortirent ensemble :
Mademoiselle de l'Epine, qui avait
son projet, entraîna David dans la
campagne, et se fit reconnaître
d'une troupe de Vendéens. - « Voilà
mon libérateur, leur dit-elle, il
est digne de marcher sous votre
drapeau ». Et elle supplia David de
la suivre à l'armée royale... Mais
le modeste employé de la République
fut incorruptile. Il dit adieu à la
jeune fille et regagna l'arsenal
d'Angers.
Quand la paix ferma les plaies de la
France, David, élevé en grade par
une conduite exemplaire était à
l'arsenal de Châlons-sur-Marne. Il y
reçut une lettre dont voici la
teneur: « Je n'ai point oublié que
je vous dois l'honneur et la vie. Je
viens m'acquitter en vous offrant ma
fortune et ma main. Signé :
Mademoiselle de l'Epine. »
David fut touché jusqu'aux larmes et
vivement tenté ; mais Républicain
jusqu'au bout il refusa
discrètement. Le dénoûment n'est-il
pas digne de l'aventure ? (1)
(1) Pitre-Chevalier; pages
524-525.
RETOUR DE LA ROCHEJAQUELEIN DANS LE
BOCAGE
SA MORT (29 Janvier 1794)
Turreau et les représentants avaient
appris à Noirmoutier que La
Rochejaquelein, de concert avec
Stoffet et Bernard de Marigny,
occupait le territoire de Châtillon,
d'Airvault, de Thouars et de Cholet,
et qu'il n'attendait que le retour
du printemps pour attaquer les
postes disséminés dans le centre de
la Vendée. Le jour où ils avaient
passé la Loire, Henri de la
Rochejaquelein et ses compagnons,
séparés de leurs troupes errèrent
toute la journée, sur la rive droite
sans avoir pu trouver un asile.
Quelques jours après ils arrivèrent
à Châtillon et de Châtillon à
Saint-Aubin-de-Baubigné, où Mlle de
la Rochejaquelein s'était réfugiée.
Après avoir pris des informations
sur l'état du pays et rassemblé les
débris de l'ancienne armée, ils se
rendirent à Maulévrier, auprès de
Charette, qui fit au jeune
généralissime de la Grande Armée
l'accueil que l'on sait. Avec les
soldats dont il dispose il se rend à
Néry, où il opère un nouveau
rassemblement, marche toute la nuit
pour enlever un poste républicain,
et les nuits suivantes pour faire
des expéditions semblables, mais à
de grandes distances, pour jeter
l'incertitude sur sa marche et faire
croire à l'ennemi qu'il y avait
différentes troupes. Le 24 janvier
il lance mille hommes sur Amey et
Cordelier, emporte Chemillé,
s'empare des subsistances amassées
par la colonne républicaine qui
venait de fuir, pille tous les
fourgons de l'état-major, fait fuir
Turreau, s'établit avec Stofflet
dans la forêt de Vezins, et fait
chaque nuit une sortie sur les
Bleus. Jamais le héros n'avait joué
sa vie avec une telle audace. Il la
rencontra le 28 janvier 1794.
Henri était convenu avec MM. de
Bruc, de Livernière et du Cléré de
les joindre en Vallet pour arrêter
les incendiaires de Turreau. Il
s'élance chemin faisant sur une
colonne qui brûlait Nouaillé. Il
remporte sa dernière victoire et
fait sa dernière .bonne action. Ses
soldats allaient tuer deux gendarmes
bleus surpris dans un champ. «
Arrêtez ! leur crie-t-il, je veux
interroger ces hommes ». Et il va
droit à eux malgré Stofflet et
Beaugé. « Rendez-vous, leur dit-il,
je vous fais grâce ». Mais un de ces
forcenés a entendu prononcer son nom
; il le couche en joue et le tue à
dix pas. La balle avait frappé au
front.
Stofflet reçoit au cœur le
contre-coup ; il s'élance les yeux
en larmes, - lui qui n'avait jamais
pleuré ! - « Qui de vous,
misérables, a tué notre général ? -
Moi, répond le meurtrier. Et
Stofflet lui ouvre le crâne d'un
coup de sabre. Puis s'adressant, à
son compagnon : « Toi, tu es libre ;
M. Henri t'a fait grâce ». Avertis
de l'approche d'une colonne ennemie,
les compagnons de la Rochejaquelein
lui creusent à la hâte une fosse et
l'ensevelissent avec son meurtrier.
- Les restes du héros furent exhumés
en 1816, et le 7 mars 1817,
transportés dans le caveau de
famille à St-Aubin-de-Baubigné.
Ainsi mourut l'un des plus nobles et
des plus dignes enfants de la
Vendée. Sa carrière fut courte mais
elle fut brillante, et aucune ombre
ne ternit jamais l'auréole si
radieuse et si pure de cet enfant de
vingt ans.
« Ce héros ! le plus jeune et le
plus brillant général qu'ait eu la
Vendée, n'avait que vingt et un an,
s'écrie Napoléon, qui sait ce qu'il
fut devenu ? »
PRISE ET REPRISE DE CHOLET (19
Février 1791)
SUCCÈS ET REVERS DE STOFFLET
IL SE RÉFUGIE DANS LA FORÊT DE
VEZINS
Stofflet résolut de venger la mort
de La Rochejaquelein. Dans la même
journée il bat les Bleus à Gesté et
à la Regrippière. Secondé par Pierre
Cathelineau et Beauregard, il
promène ses bandes à.Beaupréau,
Chemillé, Vezins, Coron, enlève les.
hauteurs du Coudray-Monbault à la
brigade Carpentier, pousse jusqu'à
Vihiers, d'où il revient dans la
forêt du Vezins, qu'il quitte de
nouveau le lendemain, 7 février,
marchant sur Maulévrier, où il
décide de faire le siège de Cholet.
Le 9 février 1791, il attaque
vigoureusement cette ville à la tête
de cinq mille hommes et s'en empare.
Le général Moulin, qui portait des
culottes faites de la peau des
Vendéens qu'il avait tués, est
blessé et se brûle la cervelle de
rage d'avoir été vaincu par ces
paysans. Mais Cafin prend sa place
et commence à rallier les fuyards.
La division Cordelier arrive, et
devant ces nouvelles forces les
Vendéens reculent jusqu'à Chemillé
(1).
Stofflet attaque le 11 février, avec
sept mille hommes, la division de ce
général, forte des héroïques débris
de l'armée de Mayence, mais
Cordelier le bat par son propre
système à Beaupréau et à la
Regrippière en égaillant aussi ses
soldats. Puis il court arrêter le
succès de Charette dans le
Bas-Poitou. Stofflet se retranche
dans la forêt de Vezins, d'où il
repousse Huché et Grignon. Le 22
février (2), les royalistes de la
Haute-Vendée s'emparent de Cerizay,
le 21 de Bressuire, où ils trouvent
des vivres en abondance ; le 26
d'Argenton-le-Château.
Dans le Bas-Poitou, Charette, traqué
sans cesse par les Colonnes
infernales, errant au milieu de
l'hiver rigoureux de 1794, dans les
bois et sur les landes couvertes de
neige des paroisses des Lucs, de
Saligny, de Saint-Sulpice et de la
Copechagnière, échappe à force
d'adresse et d'audace aux divisions
républicaines qui sillonnent le
pays. Souvent même, de peur d'être
trahi par la fumée, il ne peut
allumer de feu de bivouac pour se
dégeler les membres.
Renseigné et secondé par des enfants
et des femmes qui courent nu-pieds
dans la boue et dans la neige, il.
tient tête, pendant cette campagne
admirée comme un chef-d'œuvre de
tactique militaire, aux vainqueurs
de l'Europe coalisée. Le 27 janvier
il attaque avec Sapinaud
Saint-Fulgent, et y bat les Bleus
occupés à relever l'arbre de la
liberté. Battu le lendemain aux
Quatre-Chemins, il rentre dans la
forêt de Grala et en sort le 31
janvier pour défendre les Brouzils
contre la colonne du général Dufour.
Il a le bras fracassé par une balle,
mais n'en continue pas moins de se
battre jusqu'à ce qu'il tombe
évanoui. Le lendemain, il s'empare
de Maché, où il trouve un convoi de
vivres, et peut à peine se reposer
quelques heures au Val de Morière,
près Touvois.
Le jour de la Chandeleur (2
février), il met en fuite le général
Joba, tue six cents hommes à
Grignon, près de Saint-Fulgent et
culbute le général La Chenaie près
de Chauché(3), remportant ainsi
trois victoires coup sur coup avec
des troupes peu nombreuses et
exténuées de fatigue, et qui se
vengent par la mort des prisonniers,
des incendies allumés sur leur
route. - Le 8 février on se bat à
Saint-Colombin, où La Roberie blesse
ou tue de sa main trois dragons
acharnés contre lui ; puis Charette
apprenant que les Bleus mettaient
tout à feu et à sang du côté de
Légé, il s'avance avec Joly et
Couëtus pour délivrer ce malheureux
pays. Il bat Cordelier dans le
bourg, puis au bord d'un torrent, où
celui-ci laisse huit cents morts et
toutes ses munitions.
(1) Le lendemain, 22 pluviose, an
II , le Comité de Salut public
prescrivit de désarmer sur-le-champ
toutes les communes vendéennes
comprises dans le cercle forméé par
les places de Saint-Gilles, Les
Sables, Luçon, Niort, Airvault,
Thouars, Saumur, et depuis Saumur
jusqu'à Nantes, toute la rive gauche
de la Loire, et depuis Nantes
jusqu'à Saint-Gilles, tous les
points de la circonférence exceptés.
Dans toute l'étendue du pays soumis,
il ne devait rester d'armes qu'aux
soldats de la République (La Vendée
patriote) T. II, page 255.
(2) NOUVEAUX NOMS DES COMMUNES DE
LAVENDÉE
Les noms anciens des communes sont,
croyons-nous, désignés
officiellement pour la dernière fois
durant la période révolutionnaire,
dans une délibération du district
des Sables, portant la date du 4
ventôse, an II (22 février 1794).
Le changement des noms, qui
rappelaient « des idées de fanatisme
et de féodalité », s'opéra
successivement â dater du 24
pluviôse, an II (14 février 1794),
où, sur le registre des
délibérations municipales de
Saint-Gilles, on trouva pour la
première fois la désignation de
Port-Fidèle. Le même mois, l'lle
d'Yeu se dénommait île de la
Réunion, Croix-de-Vie s'intitula
Havre-de-Vie. Le 14 prairial (5
juin) ; furent reconnus par le
district des Sables, en outre des
précédents, les changements de noms
suivants :
Château-d'Olonne, Beauséjour;
Saint-Martin-de-Brem, Havre-Fidèle ;
Saint-Nicolas-de-Brem, Bellevue ;
Saint-Julien-des-Landes, Landes ;
Chapelle-Achard, Belle-Chasse ;
Sainte-Flaive, Louvetière ;
Sainte-Foy, Le Désert ;
Saint-Georges-dePointindoux,
Carrière-Grison ; Le Bernard,
Bonfond ; Longeville, Salerne ;
SaintBenoît, Bon-Marais ;
Chapelle-Hermier, Josnay ;
Landeronde, Bonne-Lande ; Les
Moutiers-les-Mauxfaits, Les
Moutiers-les-Fidèles,
Champ-Saint-Père, Champ-Perdu ;
Saint-Avaugour, Les Palières ;
Saint-Cyr, Haute-Plaine ;
Saint-Sornin, le Bois ;
Saint-Hilaire-de-Talmont. Le Tanès ;
Saint-Hilaire-la-Forêt, La
Vineuse-en-Plaine ;
Saint-Vincent-sur-Jard, Le Goulet.
Chassin, T. IV. La Vendée
patriote (1793-1800). Voir aussi
La Vendée historique, IIIe
année, 559-60 et 61.
(3) Dans les premiers jours de mars
de cette année 1794, une partie de
la commune de Chauché fut brûlée par
les Colonnes infernales, notamment
le village de la Brejonnière ; une
seule maison fut épargnée : celle
d'un nommé Mandin, qui, le 2 février
précédent, avait donné l'hospitalité
au chef qui commandait la colonne
incendiaire. (Alexis des Nouhes,
Échos du Bocage) année 1885, n°
III.
FÉROCITÉ DE JOLY, dit le « BRUTUS
VENDÉEN »
Le féroce Joly vit tomber là deux de
ses fils, dont l'un mortellement. Il
pleurait comme une mère sur le corps
de l'aîné, lorsqu'on amène les
prisonniers bleus. Un d'eux se jette
aux pieds du vieillard en criant : «
Grâce, mon père ! Vous savez que je
n'ai fait que céder à la force ! » -
C'était en effet le troisième fils
de Joly qui servait la
République.... Le Brutus vendéen le
repousse et le fait fusiller avec
tous ses compagnons. Les Vendéens ne
pardonnèrent jamais cette barbarie
au général.
ARRIVÉE DU GÉNÉRAL HAXO (1)
Encore une fois Charette était
maître du pays, mais il ne put
rester, à Légé, infecté par les
retranchements de cadavres. Haxo fut
alors lancé contre lui. Le 28
février il est à Machecoul, le 1er
mars à Légé, le 2 à La Mothe-Achard.
- « Dans six semaines, écrivait-il
au Comité de Salut public, j'aurai
la tête de ce brigand ou il aura la
mienne ! »
Cette parole superbe était connue
dans la Vendée : partout on ne
parlait que du général Haxo.
Alsacien comme tant d'illustres
généraux de la République, faisant
la guerre en soldat, mais non pas en
bourreau : ce qui le rendait
d'autant plus redoutable. Tout le
monde s'entretenait de la lutte qui
allait s'ouvrir entre ces deux
hommes.
Charette, cantonné dans la forêt de
Rocheservière, ne fut point
épouvanté de l'orage qui l'allait
menacer.
Avec des soldats manquant de tout,
il laisse la forêt, s'ouvre un
passage à travers les Bleus, les
culbute près
Saint-André-Treize-Voies ; le 5
mars, secondé par Guérin, son
intrépide lieutenant (2), il bat
Haxo à la Vivantière, mais bientôt
Haxo triomphe à son tour à
Saint-Sulpice (7 mars), et enfonce
les Blancs dans la forêt de Touvois.
(1) Haxo, né à Étival (Vosges) le 7
juin 1749, avait servi dans le
régiment de Touraine, infanterie, de
1768 à 1777 ; il en avait été
congédié fourrier. Conseiller au
bailliage de Saint-Dié en 1789, puis
administrateur du département des
Vosges et major-général des gardes
nationales en 1790, il avait répondu
à l'appel des volontaires en 1791,
et avait été élu lieutenant-colonel
du troisième bataillon de son
département le 29 août. Promu chef
de brigade pendant le siège de
Mayence, il obtint le grade de
général de brigade le 17 août 1793.
Il prit une belle part aux deux
campagnes des Mayençais en Vendée,
et fut gardé sur la rive gauche de
la Loire pour combattre Charette
pendant l'expédition d'Outre-Loire,
puis dirigea ensuite les opérations
qui aboutirent le 3 janvier 1794 à
la reprise de Noirmoutier, et se fit
tuer bravement au combat des
Clouzeaux (20 mars). La Convention
décréta le 28 avril 1794 que son nom
serait inscrit sur une colonne de
marbre au Panthéon. La ville de La
Roche-sur-Yon a donné le nom de ce
vaillant général à une de ses
principales rues. - Disons aussi que
par ordre de Haxo, et malgré des
injonctions réitérées, la Contrie,
maison de Charette, près la
Garnache, resta debout.
(2) Guérin commandait les Paydrets,
c'est-à-dire les habitants des
paroisses situées entre Nantes et
Machecoul, pays de Retz ! Il avait
remplacé La Cathelinière, fusillé à
Nantes.
COMBAT DES CLOUZEAUX. - MORT DE HAXO
(21 Mars 1794)
Après avoir séjourné pendant
quelques jours au milieu des bois et
rallié les fameux gâs du pays
de Retz, les Paydretz,
Charette, avec Joly, qui est venu à
son secours, s'avance sur Chauché
pour surprendre La Roche-sur-Yon par
un mouvement tournant et attirer
l'ennemi dans un piège. Les Vendéens
étaient aux Clouzeaux (1) se
dirigeant sur La Molhe-Achard,
lorsqu'on vint leur annoncer
l'approche du général Haxo. Charette
donne aussitôt le commandement de la
gauche à Joly, celui du centre à
Guérin et garde l'aile droite pour
lui : La cavalerie, placée sur les
coteaux environnants devait protéger
la retraite en cas de revers.
Haxo, impatient d'en finir, et se
figurant qu'il ne va faire
qu'unebouchée des Vendéens, se
précipite à la baïonnette sur
l'avant-garde de Joly qui soutient
bravement le choc : au même moment,
la cavalerie accourt aux cris de :
Mort aux Bleus ! et la mêlée devient
affreuse.
En vain Haxo, toujours repoussé,
revient six fois à la charge, il ne
peut entamer les Vendéens et il
tombe bientôt de cheval (2) atteint
d'une balle à la cuisse. Alors il
s'adosse à un arbre, donne ses
derniers ordres, et, le sabre en
main, brave toute l'armée Vendéenne
! - « Rendez-vous ! » lui crie un
paysan ; et pour toute réponse il
l'étend à ses pieds. Il pare de même
les coups d'un autre, et cinq hommes
reculent devant cette tête blanche
inondée de sang, cette taille
gigantesque et ce sabre «
inévitable. » - Enfin Arnaud de la
Mouzinière de Mormaison, blessé par
le général, l'achève de trois balles
presque à bout portant. Charette,
triomphant sur tous les points,
accourait pour lui sauver la vie.
(1) Lire dans La
Revue du Bas-Poitou (5e année, pages
128 à 139), un article fort
intéressant intitulé :
La mort du général
Haxo et le combat des Clouzeaux.
(2) Son cheval fut saisi par des
Tesson de Belleville, qui
s'emparèrent de sa valise contenant,
disait-on, une forte somme d'argent;
en tout cas ce n'était un mystère
pour personne après 1814, que
l'aisance de ces métayers
misérables, lors de l'affaire des
Clouzeaux, avait eu ce point de
départ. (Rouillé. Le Messager de la
Vendée 13-27 mars et 17 avril 1892).
- Chassin. La Vendée patriote. Tome
IV, page 381.
Haxo, d'après Aubertin, aimait à
citer cette maxime de la Pharsale
: « Unica belli proemia
civilis, victis donare salutem
». Dans une guerre civile, le seul
gain de la victoire, c'est de sauver
les vaincus.
RÉORGANISATION DE NOUVELLES BANDES
ROYALISTES
PRISE DE MORTAGNE-SUR-SÈVRE PAR
MARIGNY (25 Mars 1794)
Tandis que Charette, pendant une
admirable campagne d'hiver de trois
mois, reprend son ancien territoire,
Marigny, après avoir, déguisé en
marchand de volailles, bravé Carrier
jusqu'au cœur de Nantes, se met à la
tête des gars de Bressuire, de
Mortagne et des environs, et la
Vendée a désormais trois généraux :
Charette, Stofflet et Marigny.
D'un autre côté, Sapinaud de la
Rairie, aussi revenu d'Outre-Loire,
avait réorganisé une armée dans la
Vendée centrale, et Fleuriot, nommé
généralissime à Savenay, tenait
toujours à la tête de sa division.
Marigny débute par un grand coup.
Vêtu de l'habit de paysan, comme ses
soldats, sans autre distinction que
sa croix de Saint-Louis, il s'empare
de Mortagne le 25 mars, à la tête de
5.000 rebelles et établit son
quartier général à Cerizay, pendant
que la garnison de Mortagne, forte
d'environ mille hommes, s'enfuit à
Tiffauges, Clisson, Le Pallet et
Nantes, où elle arrive après 26
heures de marche forcée.
Cet événement eut une portée
immense. Le Normand, accusé d'avoir
rendu la ville, éclaira la
Convention sur ses maladresses. Dès
lors elle changea diamétralement de
système, déclara les femmes, les
vieillards, les enfants inviolables,
et rendit à la guerre le caractère
qu'elle n'eût jamais dû perdre. Mais
les soldats de Charette, de Stofflet
et de Marigny, se défiant des
promesses de la Convention,
poursuivirent encore avec
acharnement la guerre des
broussailles.
ÉVACUATION DE CHOLET, LES HERBIERS,
CHANTONNAY,
LA ROCHE-SUR-YON. - MONTAIGU,
QUARTIER GÉNÉRAL.
SITUATION CRITIQUE DES TROUPES
Pour conjurer le défaut d'ensemble
entre les chefs qui prennent le
commandement de la division après la
mort de Haxo, la Convention ordonne
que Cholet sera évacué et que tous
les habitants quitteront le pays
sous peine d'être traités comme
rebelles.
Le général Turreau évacue les
Herbiers, Chantonnay, La
Roche-sur-Yon et, se fixe à
Montaigu, où il établit son quartier
général (2 avril) ; dès le lendemain
le pain manque pour nourrir ses
troupes et deux mille réfugiés.
Les troupes étaient réduites à un
quart de ration de pain dans les
districts de Challans et de
Machecoul, bien que le général Haxo
eût donné l'ordre d'excepter
provisoirement de l'incendie
Challans, la Garnache, Sallertaine
et Soullans, comme postes
militaires. Elles n'avaient qu'un
pas à faire pour se procurer des
vivres en abondance : c'était de
pénétrer dans le marais, que le
sanguinaire lieutenant de Charette,
Pajot, occupait avec quinze cents
hommes.
AFFAIRES DE CHALLANS ET DES
ENVIRONS. - CAMPS DE FRELIGNÉ ET
SAINT- CHRISTOPHE . - MAULÉVRIER,
LES MOUTIERS-LES-MAUXFAITS REPRIS,
ETC
Instruit des desseins de Turreau,
Charette essaie de s'ouvrir un
passage à travers les bataillons
républicains et de réunir ses forces
à celles de Pajot. Le 8 avril il
attaque avec huit mille hommes
Challans, défendu par puits cents
hommes aux ordres de Boussard.
Malgré la disproportion du nombre et
l'héroïsme de Charette, qui
combattit le dernier avec une
poignée de braves, les républicains
repoussèrent trois fois l'ennemi et
le mirent en déroute. Dutruy
poursuit Charette et Savin
jusqu'au-près d'Aizenay, brûlant
tout sur son passage ; le 23 et le
26 avril il fouille les forêts de
Princé, de Touvois et de Grand'Lande
; le 4 mai il s'empare du Périer «
affreux et superbe repaire au milieu
d'une nappe d'eau. » Le marais fut
cerné par des colonnes volantes, qui
ne purent néanmoins empêcher Pajot
d'aller rejoindre Charette dans le
Bocage, en emmenant dans sa fuite un
grand nombre de chevaux et de bêtes
à cornes ; mais cette expédition
longue et pénible procura d'immenses
ressources aux troupes de la
République. Le 17 juin Boussard
annonçait qu'il avait emporté les
quatre moulins autour desquels se
tenaient les débris de l'armée de
Pajot ; qu'il s'était emparé d'au
moins 30.000 sacs de farine et d'un
très grand nombre de bœufs et de
chevaux. Le 23 juin, il formait à
Fréligné et à Saint-Christophe
du-Ligneron deux camps de 5.000
hommes pour assurer la pacification
du marais.
Sur ces entrefaites, Stofflet et
Marigny avaient dirigé une
expédition infructueuse sur La
Châtaigneraie, défendue par
l'adjudant-général Lapierre, mais
ils allaient bientôt venger cet
échec. Le vendredi saint, 18 avril,
Marigny attaque les républicains
dans les allées du château de
Clisson et les met en fuite. Ils
évacuent Bressuire et se renferment
dans le camp de Chiché. Stofflet de
son côté se fortifie à Maulévrier,
dont il fait un camp, un refuge et
une imprimerie.
Ls 19 avril, Charette s'empare des
Moutiers-les-Mauxfaits, où il trouve
des vivres et des munitions en
abondance et vole au secours de
Sapinaud, qui avait formé une
nouvelle armée avec les anciens
soldats de Royrand et de
Beaurepaire. L'arrivée de Charette
et de Guérin sauve Sapinaud, qui se
trouvait cerné vers Pouzauges par
des forces supérieures (28 avril
1794) (1).
(1) Tous les hommes valides de la
Gaubretière avaient suivi Sapinaud.
MÉSINTELLIGENCE ENTRE
LES CHEFS. - ENTREVUE DE LA BOULAYE.
-
EXÉCUTION DE
MARIGNY (10 Juillet
1794)
Les succès de Marigny avaient porté
ombrage à Stofflet et à Charette.
Ils lui firent proposer une entrevue
pour règler de
concert un plan de campagne.
Sapinaud, Marigny, Stofflet et
Charette se réunirent à La Boulaye,
près Mallièvre. Ils avaient entre
eux quarante mille hommes, dont il
s'agissait de faire une puissante
armée. L'abbé Bernier arrive et
brouille les rivaux, déjà aigris. Ne
pouvant dominer Charette, il
l'empêche de dominer les autres en
fascinant Stofflet. On ne nomme donc
point de généralissime; mais on
signe une confédération vendéenne,
et l'on convient d'agir de concert,
sous peine de mort (toujours
l'impossible) (1).
Marigny doit ouvrir la campagne et
attaquer des postes républicains sur
la rive gauche de la Loire. Il se
présente au jour convenu, mais il
n'obtient pas assez de vivres pour
ses troupes qui l'abandonnent... Il
manque alors forcément à sa promesse
et échoue le 25 avril et le 2 mai
devant La Châtaigneraie. Jaloux de
lui depuis longtemps, Charette et
Stofflet l'accusent d'avoir poussé
ses soldats à la révolte, et le
traduisent le 29 avril, à la Jallais
(2), devant un conseil composé de
vingt-trois généraux et officiers.
Charette fait le rapport et conclut
à la peine capitale. Il vote en
conséquence avec Stofflet qui se
charge de l'exécution. En vain
Sapinaud, La Bouère et Beaurepaire,
etc., refusent de signer : l'arrêt
fatal est rendu par 18 voix sur 20.
Marigny l'apprend et ne veut pas le
croire « C'est pour m'effrayer »,
dit-il en souriant.
Charette se repentit, assure-t-on,
et voulut sauver sa victime ; mais
excité par l'abbé Bernier, Stofflet
arrêta Marigny, malade à la
Girardière, et le fit fusiller, le
10 juillet 1794, par des soldats
allemands. On refusa un prêtre au
condamné, qui commanda le feu avec
un héroïque courage. - « De tous les
chefs de la Vendée militaire, dit
Mme de la Rochejaquelein, aucun n'a
péri d'une mort plus déplorable et
plus révoltante. »

Marigny
Charette et Stofflet, qui s'étaient
entendus pour le mal, ne purent
s'accorder pour la bonne direction
de leurs opérations, et cependant la
République, triomphante naguère, se
résignait à la défense, et les
Bleus, que le nom seul des Brigands
terrifiait, s'abritaient derrière
neuf camps retranchés placés sous le
commandement supérieur du général
Vineux (3).
Stofflet, de son côté, partage son
théâtre militaire en huit divisions.
Charette en crée onze, et de plus
organise des tribunaux. Des mesures
imitées de la Convention fournissent
des munitions, des vivres et de
l'argent, pendant que la Convention,
pressentant Bonaparte, tremblait de
voir un dictateur surgir de l'armée.
Une chance inattendue s'offrait en
même temps aux généraux vendéens. La
Convention retournait une partie de
ses troupes vers les frontières du
Nord. Charrette convoque aussitôt
ses collègues le 1er juin, à son
camp de la Bézelière. Après un
combat acharné et malgré l'énergique
résistance des troupes régulières,
aux ordres du général Brière, il
écrase deux mille républicains dans
les landes de Bois-Jarry, et couvre
la route de leur sang jusqu'à
Moutaigu. Il était irrévocablement
convenu qu'on ne ferait plus de
prisonniers.
(1) Voir pour détails, Chassin. -
La Vendée patriote. T. IV, pages
492-93 et 94.
(2) Chassin dit que c'est à
Belleville que fut rendu l'arrêt de
mort.
(3) Ces camps étaient ainsi disposés
: Le général Ferrand à Fontenay,
siège de l'état-major, avec 3.500
hommes. - Grignon à Thouars, avec
3.600 hommes. - Dutruy en avant des
Sables-d'Olonne, avec 3.000 hommes.
- Travot à Courson, avec 4.291
hommes. - Crouzat et bientôt le
général Jacob à la Houillère, avec
4.500 hommes. -- Bonnaire à La
Châtaigneraie, avec 5.000 hommes. -
Guillaume entre la Vie et le Lay,
avec 3.600 hommes. - Legros à
Chauché, avec 1.960 hommes, et
Dusirat à Montaigu (A), avec 1.400
hommes, soit 30.850 hommes.
(A) Dusirat avait momentanément
établi son camp entre les
Quatre-Chemins et
Saint-Vincent-Sterlanges, puis à la
Chardière et .à
Saint-Georges-de-Montaigu.
INSUCCÈS DES VENDÉENS DEVANT
CHALLANS
(6 Juin 1791)
Le 6 juin, Charette, avec dix mille
fantassins et neuf cents cavaliers,
suivi de Stofflet, qui dispose de
quatre à cinq mille hommes, attaque
Challans (1). Louis Guérin, toujours
à l'avant-garde avec ses
Paydrets, enlève les premiers
postes, et Charette survenant avec
Sapinaud, l'affaire s'engage
sérieusement et devient des plus
chaudes. Tour à tour vainqueurs et
repoussés sur quelques points, les
Bas-Poitevins, mal secondés par
Stofflet qui reste l'arme au bras au
plus fort de la bataille, font des
efforts inouïs pour enfoncer les
Bleus, commandés par Dutruy. En vain
le drapeau blanc est planté deux
fois sur les retranchements, il est
abattu deux fois ; en vain Joly,
grièvement blessé, combat toujours
et fait des prodiges de valeur avec
Guérin, il fallut céder et
abandonner l'entreprise. Stofflet se
décida enfin à se mettre en ligne,
mais il ne put que couvrir la
retraite avec la cavalerie de
Rostaing.
Cet insuccès mit le comble à la
mésintelligence qui existait
toujours entre Charette et Stofflet,
et chefs et soldats se séparèrent
vivement irrités. Charette se retira
à Belleville avec 1.500 hommes, et
Stofflet se dirigea vers le
Haut-Bocage par les Quatre-Chemins
et les Herbiers.
Charette alla se consoler avec son
sérail à Belleville, et Stofflet,
reprit, à La Marozière, le joug
sacré de l'abbé Bernier, ce génie
ambitieux qui s'employait encore à
raviver la guerre, en attendant
qu'il entreprît de l'éteindre avec
tant d'habileté.
(1) La veille l'armée avait campé à
St-Christophe-du-Ligneron.
REPRISE DES HOSTILITÉS
NOUVELLE ATTAQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE
(12 Juillet 1791)
AFFAIRES DE LEGÉ (17), CHATEAU DE
BOULOGNE, PALLUAU (20 Juillet)
En ce moment Robespierre allait de
l'autel de l'Être suprême à la
guillotine, et si quelques généraux
républicains, comme Vimeux, Beaupuy
et Dumas, se montraient pleins
d'humanité, d'autres, tels que
l'ignoble Huché, continuaient à
promener la mort et l'incendie sur
la malheureuse Vendée qui, malgré
ses revers, était toujours
frémissante.
Le 12 juillet, Stofflet, Bérard et
la Bouère battent les Bleus à La
Châtaigneraie, qu'ils ne peuvent
conserver; mais le 17, Legé tombe
entre les mains de l'ennemi, malgré
Lecouvreur, commandant de la
division qui, avec les quinze cents
hommes qu'il avait avec lui, se
défendit vaillamment. - Le 19, les
républicains s'emparent du château
de Boulogne, dans la forêt de
Dompierre, où l'on trouve des
provisions considérables, de
l'eau-de-vie et du vin en barriques,
1.500 bouteilles de vin de Bordeaux
et d'Espagne, des vêtements,
matelas, etc. Le 20, nouveau succès,
où la colonne du hideux Huché se
livre encore à des massacres
épouvantables.
Battu à l'attaque du camp de Millé,
en Anjou, Stofflet, qui faillit être
fait prisonnier, est vengé par Cadi
qui, an bourg de Faye, détruit
complètement deux bataillons qui y
étaient campés.
Après le 9 thermidor (27 juillet
1794), la Convention, bien décidée
pourtant à recourir aux voies de la
douceur, rappelait tous les
représentants et tous les généraux
impitoyables. Elle engageait en même
temps, sous mains, les Vendéens à
livrer leurs chefs ; mais ces
trahisons furent rares.
INCURSIONS DES GÉNÉRAUX ROYALISTES.
- ENLÈVEMENT, PAR CHARETTE, DES
CAMPS RETRANCHÉS DE LA ROULLIÈRE, DE
FRÉLIGNÉ ET DES
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS.
Sûrs encore de leurs soldats,
Charette et Stofflet appelèrent au
contraire les Républicains sous le
drapeau blanc, et poursuivirent
chacun sa pointe d'accord avec leurs
collègues. Stofflet à Maulévrier,
Richard. à Cerizay, Sapinaud à
Beaurepaire ou à
Saint-Paul-en-Pareds, Charette dans
les environs de Legé et de Challans,
ne cessent d'inquiéter les
moissonneurs pendant les mois de
juillet et d'août, et il fallut
l'intervention vers Pouzauges, du
chef d'état-major républicain
Beaupuy, pour arrêter vers ce côté
l'offensive de Stofflet, de Richard
et de Sapinaud, qui perdirent 1.500
hommes.
Plus heureux que ses collègues,
Charette, après une tentative
infructueuse le 2 septembre, enlève,
le 6 septembre, le camp retranché de
la Roullière (1) au général Jacob
qui, en compagnie de charmantes
dames fuit jusqu'à Nantes.
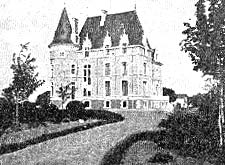
Château de Bois-Lambert
Le 14 du même mois, il enlève au
général Guillaume celui de Fréligné,
établi par le général Boussard, pour
couvrir les marais reconquis. Les
républicains se défendirent
vaillamment, se replièrent d'abord
sur le camp de
Saint-Christophe-du-Ligneron qu'ils
durent évacuer, et enfin se
concentrèrent à Challans.
Les moulins à poudre de Cparente
ayant été détruits dans la forêt de
Princé et dans le marais de Périer,
le chef royaliste se rue, le 24
septembre, sur les républicains,
près de Bois-Lambert, commune du
Bernard, et de là sur le camp
retranché des
Moutiers-les-Mauxfaits, s'en empare
de nouveau, et menace Luçon et les
Sables-d'Olonne.
C'est pendant l'affaire de Fréligné
que le jeune bleu Mermet se fit tuer
sur le corps de son père.
De son côté Stofflet gagnait du
terrain et empiétait sur l'autorité
du chef du Poitou qui, le 6
décembre, â Beaurepaire, quartier
général de Sapinaud, faisait prendre
par le Conseil un arrêté annulant la
Conférence de la Jallais. En même
temps le vieux Joly, devenu odieux
aux soldats de Charette par ses
rigueurs, et traqué dans les bois
comme un sanglier, perissait sous
les coups des gars de M. de la
Barbinière de
Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui un
dimanche, â l'issue de la
grand'messe, le prirent pour un
espion, dirent-ils, et ne le
reconnurent qu'après sa mort.
(1) Situé dans les landes de
Saint-Philbert-de-Bouaine, prés le
village de la Sauvagére.
PRÉLIMINAIRES DE LA PACIFICATION
La discorde régnait parmi les chefs
des armées vendéennes, lorsque la
République résolut de donner à la
Vendée un nouveau gage de paix :
c'était l'amnistie du 2 décembre
1794, - la tête de Carrier, son
infâme persécuteur (16 décembre
1794), et la mise en jugeaient des
principaux généraux incendiaires. -
Pour garantie de leur bonne foi, les
républicains, sur les conseils du
général Canclaux, ouvrirent partout
les portes des prisons aux
royalistes, et les proscrits cachés
en Bretagne, après la défaite de
Savenay, purent rentrer librement
dans la Vendée.
Une jolie femme de Nantes, Mme
Garnier-Chambon créole née à
Saint-Domingue, célèbre par son
dévouement aux proscrits, donne le
coup de grâce au parti guerroyant,
en se faisant le ministre pacifique
de Ruelle, successeur de Carrier
(1). Elle se rend auprès de
Mademoiselle de Charette et près de
Charette lui-même, avec M. Bureau de
la Batardière et Bertrand-Geslin,
aide-de-camp du général Canclaux.
Ils portent un décret de la
Convention qui donne aux
représentants carte blanche pour
pacifier la Vendée.
Grâce à Mlle de Charette,
l'ambassade parvient jusqu'au
général, au château de La
Roche-Boulogne. Le 28 décembre,
pendant que de Bruc et Amédée de
Béjarry avaient à Nantes une
entrevue avec les onze représentants
en mission près l'armée de l'Ouest,
Madame Garnier-Chambon l'aborde la
première en lui rendant sa sœur. Les
grâces et la bonté de cette femme le
touchent tellement, qu'il accepte
une entrevue, sur un terrain neutre,
avec Canclaux et Ruelle. Disposé à
la paix, faute de pouvoir continuer
la guerre, il consulte ses officiers
à Vieillevigne. Tous opinent pour un
traité honorable, excepté Savin, Le
Moëlle et Delaunay. Le comte de Bruc
du Cléré et Amédée de Béjarry, deux
hommes d'esprit et de cœur, sont
envoyés aux Conventionnels ;
Bertrand-Geslin répond de leurs
têtes sur la sienne. Ils s'abouchent
avec les représentants, traitent
avec eux de puissance à puissance.
Le 6 janvier 1796, des patriotes
célèbrent la fète des Rois avec les
Vendéens. Le 16 janvier, Ruelle
déclare à la tribune de la
Convention que le décret d'amnistie
a été accueilli avec transport par
les rebelles, qui ont rendu les
prisonniers faits depuis le 2
novembre. Deux jours après, le
jugement de la Commission militaire
qui condamnait la veuve de Bonchamps
à
mort était annulé par un décret de
la Convention. Le vent était à la
paix.
En vain Stofflet et Bernier
s'unirent de nouveau pour arrêter
l'élan pacifique donné par Charette
; en vain à toutes les propositions
de la Convention ils répondirent
énergiquement :. « Un roi ou la mort
! » Il fallait répondre aussi par
des victoires, et ils ne trouvèrent
que des soldats découragés (2).
(1) Elle se mit en rapport avec
Prieur de la Marne par l'entremise
du cuisinier de ce dernier, un de
ses obligés de St-Domingue.
(2) Pitre-Chevalier. |