|
        |
|
Les Templiers
|
|
 |
En moins de deux siècles
d'existence, les chevaliers de
l'Ordre du Temple ont accumulé
richesses et propriétés, se
constituant un trésor légendaire.
Militaires réputés, banquiers
internationaux, religieux
privilégiés, les Templiers ont connu
la gloire, puis la déchéance et
l'humiliation. En 1312, l'ordre est
aboli sur décision de Philippe le
Bel. Le procès des Templiers
était-il justifié ? Ordre hérétique
ou victime ? PMS a mené l'enquête.
|
|
De la gloire à la déchéance
|
|
 |
Au commencement furent les
Croisades
Insupportable pour les chrétiens
de savoir le tombeau du Christ
aux mains de mécréants ! Alors
c'est par milliers qu'en 1095
ils partent pour la première
croisade
lancée par le pape Urbain II, et
traversent les mers pour
conquérir la Terre Sainte et
reprendre possession de
Jérusalem. Voyages périlleux,
routes truffées de bandits, ils
sont nombreux à y laisser leur
vie. Deux chevaliers décident
donc de protéger cette quête
sacrée et ceux qui la
poursuivent. C'est ainsi qu'en
1119, Hugues de Payns et
Geoffroy de Saint-Omer fondent
l'Ordre des Pauvres Chevaliers
du Christ.
|
|
La prise de Jérusalem en 1099 |
|
L'armée des Templiers
Le roi de
Jérusalem,
Baudoin II, leur octroie une
partie du Temple de Salomon qui
leur vaut rapidement le nom de
"Chevaliers du Temple" ou
"Templiers". Mais ce n'est qu'en
1128, lors du concile de Troyes,
que l'Ordre est officialisé par
le pape Honorius II. Seulement 9
au départ, ils sillonnent les
routes de l'Occident pour
élargir leurs rangs et se
constituer en armée. La France
et l'Angleterre leur fournissent
le gros de leurs troupes.
|
|
Moines et soldats
|
|
 |
La bure et l'épée
"Tu ne tueras
point", ordonne Dieu dans ses 10
commandements. Prescription d'autant
plus incontournable pour ceux qui
ont fait le vœu de consacrer leur
vie au
Christ.
Pourtant, lorsque Bernard de
Clairvaux, qui a soutenu l'ordre
auprès du pape Honorius II, rédige
la règle de l'ordre des Templiers en
1128, il bouleverse les codes de la
société médiévale,
traditionnellement divisée en trois
ordres (noblesse, clergé et
tiers-état). Les Templiers
franchissent les frontières
habituelles : moines par leurs vœux
de chasteté, pauvreté et obéissance,
ils sont également soldats, maniant
l'épée et faisant couler le sang.
|
|
La croix des Templiers |
|
Une armure de fer et de foi
Ces chevaliers, généralement peu
instruits et inaptes à la
contemplation, sont attirés par
la bataille et le salut offert
par le Temple. Ils "meurent
pour leur bien et tuent pour le
Christ", ils se couvrent "le
corps d'une armure de fer et
l'âme d'une armure de foi",
écrit Bernard de Clairvaux. Leur
habit rouge et blanc reflète
cette dualité : le blanc de leur
robe est couleur de pureté et de
chasteté ; la croix rouge,
attribuée par le pape Eugène III
en 1147, rappelle leur
appartenance au christianisme
tout en symbolisant le sang.
|
|
Les banquiers de la chrétienté
|
|
 |
Aux sources de leur fortune
Ces chevaliers sans peur, "qui ne
craignent ni hommes, ni démons",
connaissent un succès immédiat.
Combattant pour le Christ, ils se
voient dotés des héritages de riches
chrétiens qui espèrent racheter le
salut de leur âme. Les dons des
nouveaux membres, apports des quêtes
de l'Eglise, loyers de leurs terres
et les privilèges octroyés par le
pape qui les exempte d'impôts font
également leur fortune.
|
|
Sceau des Templiers |
|
Gestionnaires et financiers
Les Templiers exercent une
activité économique et
financière pour subvenir aux
besoins de l'Ordre et faire
fructifier leur fortune par une
série de mesures lucratives. Ils
mettent par exemple en place un
système de changement de monnaie
qui leur permet de récupérer
plus d'argent qu'ils n'en ont
prêté. Ils inventent la lettre
de change, origine du chèque,
pour faciliter le transport des
fonds : les Croisés partant pour
la Terre Sainte pouvaient
laisser leur or dans un comptoir
occidental, voyager avec une
lettre ne craignant par le vol
et récupérer leur dû dans un
comptoir oriental. Les Templiers
stockent enfin les biens des
rois de France et d'Angleterre.
Une fortune qu'il faut gérer.
Aussi, au milieu du XIIe siècle,
les combattant sont déjà moins
nombreux que les employés,
gestionnaires ou baillis |
|
De riches propriétaire
terriens
|
|
 |
Le patrimoine
De l'Angleterre à la
Terre Sainte, en passant
par la France, le
Portugal ou Tripoli, les
Templiers sont à la tête
d'un vaste patrimoine
foncier. L'Ordre étend
ses propriétés, ou
"commanderies", à tout
l'Occident : ces
monastères, issus de
donations foncières et
immobilières, font
office de centres de
recrutement et de
formation militaires
locaux. Leur plus
célèbre commanderie est
alors la Tour du Temple,
implantée depuis 1143
dans le quartier du
Marais à Paris. Les
membre de l'Ordre y ont
notamment gardé la
fortune du roi Philippe
IV le Bel.
|
|
Les implantations
foncières de l'ordre |
|
Leur présence en
Orient
De nombreuses
forteresses
militaires se
trouvent également
au Proche Orient.
Leur siège central,
la Maison du Temple,
se trouvait
d'ailleurs à
Jérusalem de 1129 à
1187, date de la
prise de Saladin,
avant de s'installer
à Saint-Jean d'Acre.
Une escale qui ne
durera pas
longtemps.
L'extension
fulgurante de
l'Ordre prend fin
avec la neuvième et
dernière Croisade de
1271, qui précipite
la chute de
l'Occident en
Orient.
|
|
Le début de la fin
|
|
 |
Une conjoncture défavorable
Différents
facteurs peuvent expliquer la
chute des Templiers. C'est tout
d'abord la fin des Croisades qui
met en cause leur raison d'être.
Le 16 juin 1291, Saint-Jean
d'Acre, dernière place de la
Chrétienté, tombe aux mains des
Sarrasins, entraînant l'exode
des derniers chrétiens, dont les
Templiers et les
Hospitaliers,
vers l'Occident. Le siège de
l'Ordre se refugie d'abord à
Chypre avant de s'installer à
Paris. Mais de retour en
Occident, la côte de popularité
de l'Ordre décline rapidement.
L'Ordre s'est trop bien
développé pour s'intégrer
facilement dans la société. Les
autorités souhaitent restreindre
leurs privilèges jugés abusifs
et le peuple lui-même commence à
lui en tenir rigueur, insultant
et bousculant les chevaliers
qu'ils croisent dans la rue. |
|
Moines soldats au combat |
|
L'entrée en scène de Jacques de
Molay
Jacques de Molay, nouveau Grand
Maître nommé en 1293, est accusé
d'avoir sacrifié la Terre sainte
aux intérêts de l'Ordre. Alors
que le pape Nicolas IV avait
proposé de fusionner l'Ordre du
Temple avec celui des
Hospitaliers pour contrer
l'invasion musulmane, Jacques de
Molay s'est obstiné à refuser.
Enfin, des tensions de plus en
plus vives entre le roi de
France Philippe le Bel et le
nouveau pape, Boniface VIII, ont
joué en défaveur de l'Ordre.
Rentrés en France, les Templiers
dirigent de nombreux domaines et
font fructifier leurs richesses
pour le seul profit du pape, au
détriment du roi. Dans un
contexte où la France a besoin
d'argent, Philippe le Bel va
faire tout ce qui est en son
pouvoir pour s'octroyer le
"trésor des Templiers".
|
 |
|
Jacques de Molay |
|
Les Templiers, hérétiques ?
|
|
 |
La dépravation hérétique
La France du XIIIe siècle compte
sur sont territoire de nombreux
hérétiques. Il est donc facile
de profiter de l'impopularité
des Templiers pour les accuser
de "dépravation hérétique". Dès
1305, des bruits courent sur
leurs mœurs dissolues. Jacques
de Molay, humilié, demande au
pape Clément V de mener
l'enquête pour mettre fin à ces
calomnies et justifier de sa
bonne foi. Mais le pape ne prête
guère d'attention à sa requête,
pas plus qu'à celle de Philippe
le Bel qui veut faire arrêter
les renégats. Impatient, le roi
se passe finalement de son
autorisation pour lancer les
hostilités.
|
|
Jacques de Molay,
François Richard Fleury ©
Musée
National des Châteaux de
Malmaison et de Bois-Préau /
Réunion des Musées Nationaux
|
|
L'arrestation
Le 14 septembre 1307, le roi
de France, ordonne à ses
généraux d'arrêter tous les
membres de l'Ordre du Temple
présents sur le territoire
français. Le vendredi 13
octobre à l'aube, Guillaume
de Nogaret, légiste et
fidèle du roi, pénètre avec
ses troupes dans la Tour du
Temple à Paris et y arrête
138 frères. Peu surpris, ils
se rendent d'eux-mêmes à la
vue de l'ordonnance royale,
comme tous les membres qui
sont arrêtés en France au
même moment.
|
 |
|
Philippe Le Bel |
|
Luxure et perversité
|
|
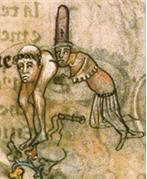 |
La propagande du roi
Perversité, luxure, avarice...
Seuls des péchés capitaux
pouvaient justifier
l'arrestation massive du
vendredi 13. Aussi, dans son
ordonnance, Philippe le Bel
accuse les Templiers "d'une
chose assurément horrible à
penser, terrible à entendre, un
crime détestable, une chose tout
à fait inhumaine". Un pacte
avec la déesse démoniaque
Asmodée, reine de la luxure,
garantissait aux Templiers
l'opprobre populaire.
|
|
Le baiser au bas de l'épine
dorsale
|
|
Une initiation orgiaque
Le rite d'initiation de l'Ordre,
à la base un simple adoubement
accompagné d'un chaste baiser
sur la bouche, devient dans les
écrits du roi, une orgie
nocturne diabolique. Les novices
seraient contraints de renier le
Christ et d'adorer des îdoles
profanes. Après avoir craché et
uriner sur un crucifix, s'être
confessé à un civil - et non à
un prêtre, et avoir renié les
sacrements, ils seraient "dépouillés
de leur vêtements séculiers et
menés nus devant le templier
chargé de les recevoir, baisés
par lui au bas de l'épine
dorsale, sur le nombril et enfin
sur la bouche". Baisers
obscènes, homosexualité... Face
à ces accusations, l'alternative
est simple : avouer et se faire
pardonner, ou mourir en
hérétiques et brûler en Enfer
pour l'éternité. |

|
|
Le Bûcher de Templiers
|
|
Les aveux
|
|
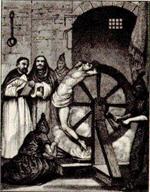 |
L'Inquisition au service du
roi
Le roi
accuse mais manque de
preuves. Son objectif :
obtenir les aveux qui
attesteront la culpabilité
des Templiers. Dès
l'arrestation, il demande
donc à ses hommes d'user de
tous les moyens nécessaires
pour les terroriser. Ils
préparent le terrain pour
l'Inquisition,
à l'époque sous contrôle de
la monarchie française.
Malgré les réticences du
pape Clément V, Philippe le
Bel demande à Guillaume de
Paris, grand Inquisiteur (et
son confesseur), d'arracher
les aveux nécessairee. En
1307, ce dernier prend la
tête des opérations,
interrogeant lui-même les 37
premiers témoins.
|
|
Torture
médiévale |
|
Avouer
ou mourir
A Paris, 138 Templiers sont
soumis à l'interrogatoire musclé
des inquisiteurs, formés pour
faire avouer les plus
récalcitrants. Torture morale,
affaiblissement physique,
menaces... Les prisonniers sont
poussés jusqu'à des états
d'hystérie et d'épuisement.
Après un régime au pain et à
l'eau et une cure sans sommeil,
les Templiers ne résistent pas
longtemps : écartelés, brûlés,
emasculés ou pendus par les
membres, 134 Templiers avouent
leur crime, 4 seulement
résistent et 25 finiront par
succomber à la torture.
|
 |
|
Le supplice de
Marsyas
© Musée du Louvre
|
|
La suppression de l'Ordre
|
 |
Les commissions pontificales
Après ces aveux, le pape Clément
V ne peut plus rester
indifférent. Le 22 novembre
1307, il diffuse la bulle
Pastoralis praeeminentiae
qui ordonne à tous les princes
d'Europe d'arrêter les Templiers
sur leur territoire. En 1308, il
relance l'enquête et fait
dresser une liste plus complète
des charges qui pèsent contre
eux. D'enquêtes en commissions
pontificales, de procès en
procès, les Templiers avouent et
démentent tout à tour, tentant
par tous les moyens de se
justifier auprès du pape,
théoriquement le seul à qui ils
doivent rendre des comptes. Mais
sous Clément V, la papauté est
également un instrument au
service de la monarchie.
|
|
Le pape Clément V
en Avignon,
Henri Ségur © Palais des
Papes |
|
Le bûcher final
En 1312, Philippe le Bel
fait pression sur le pape
qui, excédé, fait
définitivement abolir
l'Ordre. Le procès ne
s'achève réellement qu'en
1314, avec la sentence émise
contre les deux derniers
hauts dignitaires de
l'Ordre, Jacques de Molay et
Geoffroy de Charnay. Bien
qu'ils aient réitéré leurs
aveux lors de la commission
pontificale du 22 décembre
1313, la lecture publique de
leur crime sur le parvis de
Notre-Dame, en mars 1314,
leur est insupportable : ils
nient en bloc et clament
leur innocence. Furieux,
Philippe le Bel ordonne leur
mise à mort : ils seront
brûlés sur l'île de la Cité
le lendemain.
|

|
|
Lecture de la
sentence de condamnation des
Templiers, A.E Fragonard ©
Musée Magnin /Réunion des
Musées Nationaux |
|
La légende des Rois maudits
|
|
 |
La malédiction
Jacques de Molay et
Geoffroy de Charnay,
livrés aux flammes le 18
mars 1314 sur l'île de
la Cité, meurent en
prières, regards tournés
vers Notre-Dame. Mais
juste avant de mourir,
le grand maître de
l'Ordre maudit ses
accusateurs qu'il
destine à l'ire divine.
Dans un dernier souffle,
il jette l'anathème : "Clément,
juge inique et cruel
bourreau, je t'assigne à
comparaître dans 40
jours devant le Tribunal
de Dieu ! Et toi aussi,
roi Philippe !". Le
sort en est jeté.
|
|
Jacques de Molay sur le
bûcher |
|
Hasard ou mauvais sort ?
Un
mois après, le 20 avril, le
pape Clément V meurt malade,
après avoir ingurgité un
plat d'émeraudes censées le
guérir. Le 29 novembre,
c'est au tour de Philippe le
Bel de trépasser : celui
qu'on appelait le "Roi de
fer" meurt à 46 ans, en
pleine force de l'âge, d'une
attaque cérébrale. Alors que
sa succession était assurée,
les fils du roi, qui se
relayent sur le trône de
1314 à 1328, meurent tous
précocement et sans
héritier, mettant fin à la
dynastie des
Capétiens.
Victimes du sort jeté par
Jacques de Molay ? Mythe ou
réalité ? La légende,
popularisée par le romancier
Maurice Druon, les rendra
célèbre sous le nom des
"Rois maudits".
|
|
 |
Les héritiers
Après l'abolition de l'Ordre
du Temple en 1313, se pose
le problème de la
répartition de sa fortune.
Le roi Philippe Le Bel, qui
la convoite depuis
longtemps, avait déjà essayé
de s'en emparer en accusant
les Templiers de pactiser
avec le diable : leurs
richesses, acquises avec
l'aide de Satan,
reviendraient de droit au
Royaume de France.
L'argument ne fait pas
mouche. Il suggère donc au
pape de créer un nouvel
ordre militaire, héritier
des Templiers, qui serait
dirigé par un membre de la
famille royale. Après de
longues hésitations, le pape
lègue finalement les biens
aux Hospitaliers, ordre
militaire évangélique créé
au milieu du XIe siècle. Le
roi accepte cette solution
tout en ponctionnant ce
qu'il peut grâce aux taxes
et impôts.
|
|
Les Chevaliers de l'Hôpital |
|
Saint-Graal ou trésor de
Salomon?
Bien qu'elle ait été
essentiellement foncière, la
richesse des Templiers est
devenue mythique. La légende
s'est répandue à cause du
fameux vendredi 13, jour de
l'arrestation des Templiers.
Les gardes de Guillaume de
Nogaret, chargés de faire
l'inventaire des biens,
n'auraient pas trouvé un écu
dans la Tour du Temple. On
imagine alors que les
Templiers, avertis de
l'arrestation, auraient pris
soin de cacher leur magot.
Dès lors, toutes les
spéculations sur la nature
et sur l'origine du trésor
ont été émises : Saint Graal
pour certains, trésor de
Salomon pour d'autres, il
serait enfoui quelque part
en France, voire en
Amérique, où des
francs-maçons l'auraient
emporté après l'indépendance
des Etats-Unis. L'énigme
reste entière et, à ce jour,
aucune trace du fameux
trésor n'a été retrouvée |
|
| |
|
|